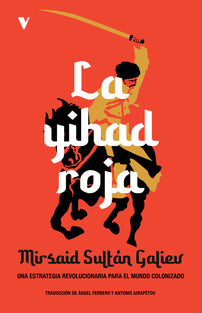Laurent Lévy publie aux éditions Arcane 17 un livre passionnant sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’échec, dans les années 1970, d’une stratégie de « voie démocratique au socialisme » par le PCF : Histoire d’un échec : la stratégie « eurocommuniste » du PCF (1968-1978). Nous donnons ici à lire de larges extraits de la partie de l’ouvrage consacrée à l’abandon en 1976, lors du XXIIe Congrès de ce parti, de l’expression « dictature du prolétariat ».

Le cœur du XXIIe Congrès est […] de tracer les grandes lignes de ce que serait le socialisme pour la France et les moyens d’y parvenir. Mais ce qui en sera retenu comme étant le plus spectaculaire – tant pour les observateurs extérieurs que dans la mémoire du parti communiste lui-même – sera un point à bien des égards anecdotique, mais qui réfracte plusieurs questions fondamentales. Ce sera […] ce qui donnera au congrès son plus grand retentissement : « l’abandon de la dictature du prolétariat ».
Bien que cette question presque symbolique ait ainsi été au cœur de la réception du XXIIe Congrès, elle n’en constituait pas l’essentiel : ces mots étaient absents de ses textes préparatoires, cela n’était donc, par hypothèse, pas l’objet de la discussion prévue. Elle ne surgira que lorsque la plupart des assemblées de cellules et bon nombre des conférences de sections, et donc la discussion par la base communiste du projet de résolution, auront eu lieu. Lors de la discussion par le Comité central de l’avant-projet du texte à soumettre au congrès, aucune intervention n’y avait souligné – pour l’approuver ou pour la désapprouver – l’absence de l’expression « dictature du prolétariat ».
Il y avait d’ailleurs bien longtemps que le PCF ne l’utilisait plus dans sa littérature, et sa disparition aurait parfaitement pu passer aussi inaperçue que celle de « démocratie avancée ». On en trouvait certes […] une occurrence dans le Manifeste de Champigny, au terme d’un bref développement insistant sur le caractère démocratique et temporaire de ce qui était ainsi désigné, mais elle n’était jamais mobilisée dans les textes du Parti. En 1973, Le Défi démocratique ne l’employait pas, et personne ne s’était ému de cette absence. […] L’idée d’un abandon exprès avait déjà été formulée à deux reprises au sein du Comité central, sans susciter de réaction : en 1974 par Henri Fiszbin et en 1975 par Pierre Juquin.
Plus de trente ans plus tard, Charles Fiterman dira de cette notion : « Elle constituait une sorte d’icône sur la cheminée dont il fallait se débarrasser pour donner tout son sens à la démarche engagée »[1]. Et de fait, avant même d’être explicitement abandonnée, l’expression « dictature du prolétariat » avait de facto disparu. François Hincker, revenant un an plus tard sur cet « abandon », remarquera non sans pertinence :
« Il s’est creusé ainsi un écart béant entre ce qui était appris dans les écoles du Parti – où la dictature du prolétariat tenait toujours une certaine place – et la pratique politique où elle était rigoureusement hors du champ non seulement des préoccupations immédiates, mais aussi de l’horizon à atteindre. Le XXIIe Congrès a fait coïncider la théorie et la pratique[2]. »
L’absence de l’expression « dictature du prolétariat » dans le projet de résolution n’était, cela dit, pas pour autant le simple résultat de sa tombée en désuétude. Elle avait même, comme le racontera Pierre Juquin, été soulignée par Jean Kanapa lorsqu’il avait présenté à la commission chargée de le mettre au point la trame qu’il en avait rédigée : « On pourrait même se poser – je ne propose pas d’en parler maintenant – la question de la « dictature du prolétariat ». » Sa remarque avait suscité le désaccord de plusieurs membres de la commission, dont René Andrieu. Le silence du projet de résolution est ainsi le fruit d’un compromis : pas d’emploi des mots « dictature du prolétariat », mais pas d’abandon explicite. C’est au cours des débats ultérieurs, dans les mois qui suivent, que le silence sera levé.
L’un des aspects remarquables de cet « abandon » est la manière dont il a été proposé : au cours d’une émission de télévision, en réponse à la question d’un journaliste. Cette question ne tombait pas du ciel : elle faisait référence à une contribution en ce sens, parue le jour même dans la tribune de discussion ouverte pour le congrès dans L’Humanité. Et cette contribution avait été suscitée par Pierre Juquin, qui regrettait le compromis du silence.
Il avait saisi l’occasion d’un débat organisé dans le cadre de la préparation du congrès dans une ville de province, au cours duquel un militant avait émis l’idée qu’il serait « illogique » de prétendre accorder l’orientation de la résolution avec la « dictature du prolétariat », pour lui suggérer de reprendre son raisonnement dans une contribution écrite – qu’il se chargea de faire publier dans L’Humanité le 7 janvier, jour où Georges Marchais était invité sur Antenne 2. Rien n’était laissé au hasard : l’attention des journalistes avait été attirée sur cette contribution particulière, et loin d’être pris au dépourvu, le secrétaire général avait bien préparé sa réponse : « Eh bien, oui, prolétariat, c’est trop étroit ; dictature, ça fait peur. Ce camarade a raison ! »
C’est ainsi cette réponse qui, d’une certaine façon, ouvrait le débat et y mettait fin d’un même mouvement, compte tenu du poids que les traditions du parti communiste donnent à la parole du secrétaire général : les contributions sur cet abandon vont, après cette déclaration publique, se multiplier dans la tribune de discussion et dans la presse du Parti, et le 16 janvier 1976, le Comité central y reviendra longuement dans une discussion à laquelle participent plusieurs de ses membres, de toutes les générations. D’entrée de jeu, toutefois, la ligne y est donnée, et c’est dans le rapport qu’il présente lors de cette réunion que Georges Marchais l’affirme dans des termes qui ne souffrent guère la discussion : « Le principe de la dictature du prolétariat sera abandonné par décision du congrès. Le projet de résolution sera amendé dans ce sens ».
Dans la discussion qui s’ensuit, François Billoux, ancien dirigeant du Parti, proche de Thorez depuis la fin des années 1920, ministre à la Libération, affirme que « la dictature du prolétariat ne correspond plus à une réalité moderne », Henri Fiszbin voit un avantage politique à l’abandon (sans rappeler qu’il avait déjà en vain exprimé cette idée), en estimant qu’il permettra « de rallier un maximum de gens à l’union et au PCF », Paul Boccara soutient l’abandon « du point de vue de la théorie marxiste », Henri Krasucki considère la notion de dictature du prolétariat « dépassée, parce que trop étroite » et « ne correspondant plus à une réalité actuelle. » Outre le mot « dictature », celui de « prolétariat » fait l’objet de remarques de la part de plusieurs intervenants.
Réticences internes
Dans un rapport présenté le 22 janvier devant le Bureau politique, Jean Kanapa avait fait le point de la discussion sur cette question dans le Parti :
« Au niveau de la tribune, et compte tenu de ce que ce sont surtout les « pas d’accord » qui écrivent le plus spontanément, nous comptions hier matin 43 lettres pour le maintien de la dictature, 22 pour l’abandon, 10 hésitants. Compte tenu de ce que j’ai dit, la proportion est excellente. Naturellement, elle va se modifier au profit de ceux qui veulent le maintien – puisque, déjà depuis une semaine, ce sont surtout ceux qui ont été battus dans leur conférence de section ou fédérale qui écrivent là-dessus comme un recours, d’ailleurs normal.
Au niveau des conférences fédérales, par contre, l’accord est unanime au moment du vote. Plusieurs conférences jugent nécessaire de le signaler dans leur résolution. […] Au cours des conférences de sections et fédérales, quelques camarades […] souhaitent qu’on leur explique clairement que le Parti ne renonce pas à son caractère révolutionnaire, qu’il est bien résolu à lutter pour le socialisme, que la classe ouvrière a bien le rôle dirigeant, qu’elle défendra son nouveau pouvoir.
Si ceci est bien expliqué, ils font confiance au Parti. Ceux qui restent irréductiblement attachés à la dictature du prolétariat sont en définitive très peu nombreux, et ils n’en font pas une question pour leur appartenance au Parti, pour leur confiance dans le Parti. On peut donc parler d’un accord quasi unanime. […] La discussion aura permis un progrès important de l’assimilation de la politique du Parti pour la masse du Parti (membres et cadres). C’est ce que nous voulions. »
Plusieurs passages de ce rapport méritent attention, car entre les lignes, ils disent beaucoup sur le fonctionnement du Parti et la manière dont la direction l’envisage. Le fait que deux fois plus de contributions adressées à la direction pour la tribune de discussion sont hostiles plutôt que favorables à l’abandon apparaît à Kanapa comme de peu de signification, au motif que c’est généralement pour exprimer un désaccord que l’on prend sa plume, et la proportion lui semble ainsi encourageante.
Lorsqu’il évoque l’accord unanime, ou quasi unanime dans les conférences fédérales, la manière presque paternaliste dont il parle des militants est frappante : « ils souhaitent qu’on leur explique… », et une fois qu’on l’a fait, « ils font confiance au Parti ». On ne peut mieux exprimer le caractère descendant de la réflexion sur cette question. Pire en un sens, pour une discussion de congrès, son objectif déclaré semble être « l’assimilation de la politique du Parti pour la masse du Parti (membres et cadres) », bien plus que son élaboration.
L’abandon
Devant le congrès lui-même, le secrétaire général présente ainsi cet « abandon » :
« Si la « dictature du prolétariat » ne figure pas dans le projet de document pour désigner le pouvoir politique dans la France socialiste pour laquelle nous luttons, c’est parce qu’elle ne recouvre pas la réalité de notre politique, la réalité de ce que nous proposons au pays. […] :
– Le pouvoir qui conduira la transformation socialiste de la société sera le pouvoir de la classe ouvrière et des autres catégories de travailleurs, manuels et intellectuels, de la ville et de la campagne, c’est-à-dire de la grande majorité du peuple.
– Ce pouvoir se constituera et agira sur la base des choix librement exprimés par le suffrage universel ; et aura pour tâche de réaliser la démocratisation la plus poussée de toute la vie économique, sociale et politique du pays.
– Il aura pour devoir de respecter et de faire respecter les choix démocratiques du peuple.
Contrairement à tout ceci, la « dictature » évoque automatiquement les régimes fascistes de Hitler, Mussolini, Salazar et Franco, c’est-à-dire la négation même de la démocratie. […] Quant au prolétariat, il évoque aujourd’hui le noyau, le cœur de la classe ouvrière. Si son rôle est essentiel, il ne représente pas la totalité de celle-ci, et à plus forte raison l’ensemble des travailleurs dont le pouvoir socialiste que nous envisageons sera l’émanation. Il est donc évident que l’on ne peut qualifier de « dictature du prolétariat » ce que nous proposons aux travailleurs, à notre peuple. »
Si l’explication proposée est limpide, on voit qu’elle est purement rhétorique ; elle tient au sens pris dans l’histoire par chacun des deux mots qui composent la formule, le mot « dictature » et le mot « prolétariat », à ce qu’ils évoquent dans le langage commun et non à la signification que donnait la théorie marxiste classique à l’expression dans son ensemble. Lénine disait que le plus démocratique des États bourgeois n’est que la dictature de la bourgeoisie, et que la dictature du prolétariat serait plus démocratique que la plus démocratique des démocraties bourgeoises. La théorie marxiste insistait sur l’articulation dans ce concept d’une théorie de l’État et d’une théorie des classes sociales.
Tout cela semble oublié, comme semble oubliée la notion de suspension de la légalité bourgeoise : cela n’est pas l’objet du débat. Quels que soient ses usages passés, le mot « dictature » est en somme devenu synonyme de « tyrannie » ou de « despotisme », et le mot « prolétariat » évoque désormais bien moins que le « peuple », et même que la classe ouvrière ou les « travailleurs » autour desquels le rassemblement de l’ensemble des couches sociales dominées par les monopoles capitalistes doit se faire.
Un point frappant dans cette explication est dans le choix des régimes politiques évoqués par le mot « dictature ». Georges Marchais parle des dictatures des régimes fascistes du passé et du présent, mais pas de celui auquel l’expression « dictature du prolétariat » ferait spontanément penser les observateurs et les critiques du communisme : la dictature imposée aux peuples d’Union soviétique après la révolution – et singulièrement la dictature stalinienne. Alors que le Parti avait quelques semaines plus tôt reconnu et dénoncé publiquement l’existence de camps de travail en URSS et la répression des opposants, la chose est pourtant claire.
Un précédent : 1964
Dans la mesure où le texte soumis à la discussion du congrès ne comportait pas cette expression, il aurait pu suffire de l’adopter tel quel, sans l’y insérer. Mais une décision explicite apparaissait néanmoins nécessaire parce qu’elle figurait dans le préambule des statuts du Parti adoptés en 1964 au XVIIe Congrès. L’ironie de cette histoire – qui aurait dû relativiser les enjeux du débat – est que la discussion avait déjà eu lieu au Comité central qui préparait ce congrès. Et dès cette époque, même s’il y avait été répondu de façon différente, la question de cette formule avait été posée dans des termes assez voisins.
Ainsi, Pierre Villon – ancien dirigeant de la Résistance armée – avait, à cette époque, proposé d’ajouter, comme le ferait quatre ans plus tard le Manifeste de Champigny, le mot « provisoire », pour parler d’une « dictature provisoire du prolétariat ». Le XVIIe Congrès le suivra sur ce point. Bien sûr, cela ne revenait pas à supprimer l’expression, d’autant que la tradition communiste avait toujours considéré la dictature du prolétariat comme quelque chose de provisoire, mais l’insistance sur ce mot signalait le risque qu’elle soit considérée comme définitive, qu’elle s’identifie avec le socialisme lui-même ; il y avait donc là, fût-ce involontairement, une critique implicite du « socialisme existant ».
D’autres allaient plus loin. Marie-Claude Vaillant-Couturier[3], par exemple, proposait que le mot « dictature » soit simplement remplacé par le mot « pouvoir ». Il s’agissait alors bien d’un « abandon » voisin de celui décidé au XXIIe Congrès. Quant à Jeannette Vermeersch[4], elle donnait un argument qui anticipait celui donné douze ans plus tard par Georges Marchais : « Hitler, disait-elle, a déshonoré le terme dictature ». Elle ajoutait que « cette phase n’est pas obligatoire pour passer au socialisme », citant en exemple le cas des démocraties populaires.
On pourrait certes discuter ce dernier point, dans la mesure où si les « démocraties populaires » dans la forme qu’avait voulu leur donner Dimitrov[5] dans l’immédiat après-guerre sous le nom de « démocratie nouvelle », étaient en effet censées avancer vers la construction du socialisme sans « cette phase », cette proposition avait très vite été inversée, et l’affirmation d’une nécessaire dictature du prolétariat avait été posée par le Kominform. Mais cette argumentation, qui peut sembler surprenante dans sa bouche, n’en anticipait pas moins la réflexion du XXIIe Congrès.
L’ironie est portée au carré si l’on songe que ses propos sont en 1964 dirigés contre le rapporteur de la commission des statuts qui n’est autre que le nouveau secrétaire à l’organisation de l’époque, Georges Marchais : en présentant son rapport devant le XVIIe Congrès, celui-ci objectera fermement à une proposition d’amendement dont il reprendra presque mot pour mot les termes dans sa propre argumentation devant le XXIIe.
La question n’est finalement tranchée que par l’intervention à l’appui de ce dernier de Maurice Thorez en personne, le mari de Jeannette Vermeersch, qui explique alors que « ce serait une faute politique que de renoncer à la dictature du prolétariat ». Ironie au cube, Jeannette Vermeersch dénoncera cet abandon trois ans après le XXIIe Congrès, dans un livre consacré à la critique de l’eurocommunisme[6]… Cette dénonciation exprimera au demeurant une bonne compréhension de ce que l’abandon signifiait réellement : une démarcation à l’égard du système soviétique, une volonté de rupture réaffirmée avec le stalinisme dont elle était notoirement nostalgique.
Longtemps plus tard, pour expliquer « l’abandon » en 2003 par la LCR de cette même expression, le philosophe Daniel Bensaïd, dirigeant et principal théoricien de cette organisation, donnera des explications plus rigoureuses, mais voisines de celles de Jeannette Vermeersch en 1964 et de Georges Marchais en 1976 – mais sans limiter ainsi les exemples de dictatures :
« Le mot dictature n’avait pas aux XVIIIe et XIXe siècles le sens absolument péjoratif qu’il a acquis depuis. Chez Rousseau, par exemple, c’est le mot tyrannie qui joue ce rôle […] Après, vu ce que sont devenues les dictatures staliniennes et autres, et plus généralement l’usage du mot dictature au XXe siècle, après Pinochet et Franco, le mot est devenu inutilisable. »
Explications
Lorsqu’il expose brièvement le ressort théorique de son choix, Georges Marchais se réfère aux classiques du marxisme :
« Sur quoi nous fondons-nous pour définir notre position dans cette question ? Nous nous fondons sur les principes du socialisme scientifique élaborés par Marx, Engels, Lénine. Il s’agit en premier lieu de la nécessité pour la classe ouvrière d’exercer un rôle politique dirigeant dans la lutte pour la transformation socialiste de la société. […] En second lieu, il s’agit de la nécessité de la lutte révolutionnaire des masses pour faire échec aux manœuvres de la grande bourgeoisie. »
En somme, Georges Marchais donne à sa position les raisons qui expliquent précisément pour les auteurs dont il se prévaut – et expliquaient pour le Manifeste de Champigny – la nécessité de la dictature du prolétariat. Quant à l’Union soviétique et son expérience propre, elle est évoquée par une distance qui n’est pas théorisée, pour justifier l’abandon par le simple effet du temps parcouru :
« Dans les conditions de la Russie de 1917, puis de la jeune Union soviétique, la dictature du prolétariat a été nécessaire pour assurer avec succès l’édification du socialisme. Il est juste de dire que, sans elle, la classe ouvrière, les peuples soviétiques n’auraient pu entreprendre ni défendre l’œuvre libératrice sans précédent qu’ils ont réalisée. C’est pourquoi les partis communistes, lorsqu’ils se sont fondés en tirant les leçons de la faillite de la social-démocratie internationale et de la victoire de la révolution d’Octobre, ont, à juste titre, dans les conditions de l’époque, adopté ce mot d’ordre. Le monde a changé. »
On note une confusion dans l’emploi du vocabulaire, où la dictature du prolétariat est dite « nécessaire » dans un premier temps, ce qui suppose qu’elle est à tout le moins un ensemble de pratiques, pour être, quelques lignes plus bas, ramenée à un simple « mot d’ordre ». Cela est assez significatif du flou théorique dans lequel s’effectue cet « abandon ». Il y a là une nouvelle illustration du peu de cas parfois fait de la théorie dans la réflexion politique des dirigeants du parti communiste, où le choix des mots d’ordre et des slogans compte plus que le travail des concepts.
Il y a autrement dit dans ces formules un équilibre extrêmement précaire entre rhétorique et théorie : la question n’est pas posée de ce qu’avait ou non été la dictature du prolétariat dans la jeune Union soviétique, ni de ce qu’avait été son devenir. L’idée d’une suspension de la légalité au profit de la classe ouvrière, de la possibilité de s’affranchir des normes juridiques dans le combat contre les anciennes classes dominantes – qui est le cœur de la théorisation léninienne – n’est pas évoquée. […] Mais cette signification de « l’abandon » n’est même pas esquissée à l’occasion du XXIIe Congrès. De fait, cet « abandon » ne porte que sur une seule chose : l’emploi – devenu quasi inexistant depuis bien longtemps – de cette expression par le PCF. […]
Louis Althusser, qui regrettait que l’on prétende « abandonner un concept comme on abandonne un chien », était au demeurant bien conscient du caractère rhétorique, plutôt que théorique, de cet « abandon », et remarquera qu’il est affirmé de façon paradoxale. Selon lui :
« Le parti communiste français vient d’abandonner officiellement, dans son XXIIe Congrès, la dictature du prolétariat, mais le même congrès a voté à l’unanimité une résolution qui repose toute entière […] sur la dictature du prolétariat, il est vrai sans jamais la nommer. »
L’affirmation est un peu péremptoire, et l’on pourrait penser au contraire que même si la théorisation de l’abandon n’est pas faite, la stratégie du PCF est désormais – comme le répètent à l’envi les délégués au congrès abordant cette question – incompatible avec la dictature du prolétariat y compris dans le sens théorique précis auquel Althusser se réfère.
Cela dit, lorsqu’il prononce ces mots lors d’une conférence sur la dictature du prolétariat donnée à Barcelone le 6 juillet 1976[7], Althusser tient à montrer quel était l’enjeu réel de cet abandon, non pas celui (selon lui impossible) d’un concept, mais celui d’une référence historique qui a peu à voir avec ce concept : la référence aux destinées de la pratique du pouvoir par les communistes russes ; la référence, autrement dit au stalinisme, même s’il n’est pas plus « nommé » que le concept « abandonné » : c’est-à-dire précisément ce sur quoi Georges Marchais ne s’exprime pas ici – alors même que son rapport comporte également une critique de la conception soviétique de la démocratie.
Enfin et surtout, il soulignera l’impasse théorique qu’il voit dans cet « abandon », en tentant de restituer le concept dans son cadre pour montrer que son abandon laisse une place vide qu’il faudra bien remplir d’une manière ou d’une autre. Il est à noter que parallèlement à cette conférence, Althusser écrira un long texte, inédit de son vivant, qui constitue une défense sans ambiguïté du XXIIe Congrès[8]. […]
« À la sauvette »
Il est ainsi permis de douter de ce que, comme l’affirme au congrès la commission des amendements par la voix de Jean Kanapa, l’absence de mention de la dictature du prolétariat relevait d’une réflexion faite de propos délibéré par le Comité central lui-même – dont on ne trouve d’ailleurs pas trace dans ses travaux avant la déclaration télévisée du secrétaire général. Cette commission évoque pourtant « la décision soigneusement pesée du Comité central de ne pas avoir recours à cette notion », ajoutant :
« Cette façon de faire a favorisé la réflexion individuelle et la recherche collective, la liberté de la discussion et le rassemblement des opinions. Et à partir d’un moment, l’intervention du secrétaire général du Parti a encore – comme l’ont dit les camarades – stimulé, impulsé, enrichi les discussions. Bien plus : elle a puissamment contribué à intéresser les masses, l’opinion publique la plus large, à notre congrès, à notre politique. Non, jamais débat ne fut moins organisé à la sauvette que celui-là ! Le résultat de ce débat est là, clair, éloquent, impressionnant : sur 22 705 délégués à nos 98 conférences fédérales, 113 seulement ont voté contre l’abandon de la dictature du prolétariat et 216 se sont abstenus. »
La présentation du déroulement du débat est ici outrageusement faussée : comme on l’a vu, aucune discussion sur cette question n’avait eu lieu avant l’intervention de Georges Marchais à la suite de la contribution parue à dessein le jour même dans L’Humanité. Cette intervention n’avait donc pas « enrichi » la discussion, mais l’avait à la fois, comme on l’a dit, ouverte et refermée – à un moment où la préparation du congrès tirait à sa fin, si bien que presque aucune cellule, presque aucune section n’avait été en mesure de discuter cette question.
En réalité, il est clair que d’un point de vue théorique, cet « abandon » s’est bien fait « à la sauvette » ; il ne repose sur aucune réflexion précise sur le sens qu’avait, dans la théorie ou dans la pratique des révolutions du passé, la dictature du prolétariat. Rien pour dire si c’est sur le fond ou seulement dans le vocabulaire qu’a lieu cet « abandon ». Rien sur la théorie de l’État, de sa destruction puis de son dépérissement, que soutient ce concept et dans laquelle il prend place.
Il est par contre exact – et tel était sans doute le véritable objectif de cette opération – que cette question a « puissamment contribué à intéresser » l’opinion publique aux travaux du XXIIe Congrès. Georges Labica pourra ainsi écrire : « L’expulsion de la dictature du prolétariat réussit ce miracle : nous faire entrer dans l’avenir en nous dispensant de faire le bilan du passé[9]. »
Notes
[1] Cité par Frédéric Heurtebize, in Le péril rouge, PUF, 2014. Entretien avec Charles Fiterman du 6 février 2009.
[2] La Nouvelle Critique, avril 1977, Une conception résolument anti-étatiste : « Les communistes et l’État ». Entretien de Béatrice Henry et Olivier Schwartz avec François Hincker et Lucien Sève, page 10.
[3] Militante très populaire dans le Parti, veuve de Paul Vaillant-Couturier, résistante, déportée à Auschwitz en même temps que Danielle Casanova et témoin au procès de Nuremberg. Elle était l’épouse de Pierre Villon.
[4] Épouse de Maurice Thorez, alors membre du Bureau politique, connue pour son soutien intransigeant à l’Union soviétique et son attachement aux traditions ouvriéristes. Elle démissionnera de la direction en 1968, pour manifester son désaccord avec la condamnation par le PCF de l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie.
[5] Prestigieux dirigeant communiste bulgare, ancien secrétaire général du Komintern.
[6] Jeannette Thorez-Vermeersch, Vers quels lendemains ? : De l’internationalisme à l’eurocommunisme, Hachette, 1979.
[7] Texte publié par la revue en ligne Période. http://revueperiode.net/un-texte-inedit-de-louis-althusser-conference-sur-la-dictature-du-proletariat-a-barcelone/
[8] Louis Althusser,Les vaches noires – interview imaginaire, PUF, 2016.
[9] In Olivier Duhamel et Henri Weber, Changer le PC ? PUF, 1979.