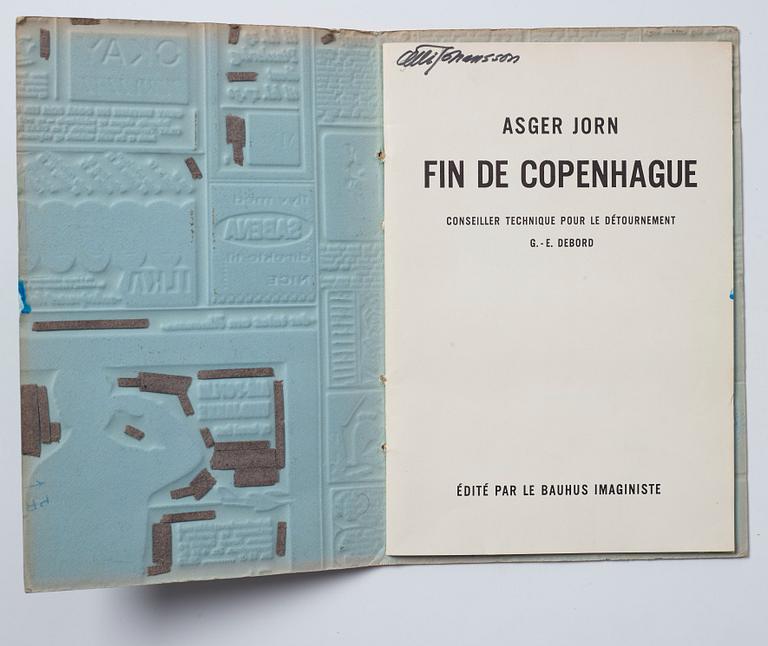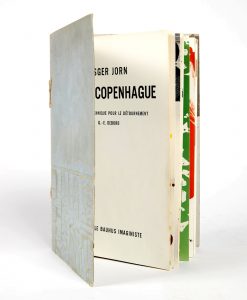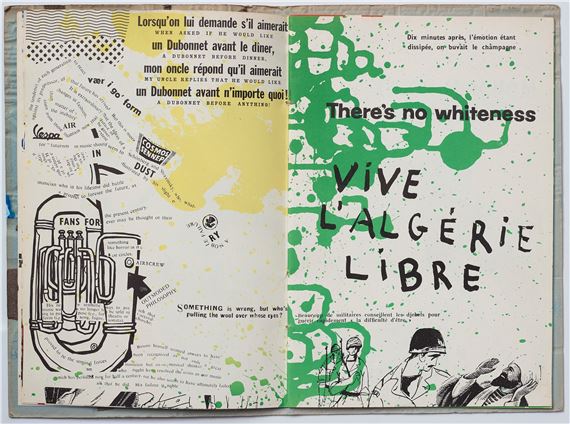Mappemonde métropolitain, métagraphie de Gilles Ivain, automne 1953 (Ivan Chtcheglov)
Partie publiée dans Œuvres, pp. 105-112:
Les gestes que nous avons eu l’occasion de faire étaient bien insuffisants, il faut en convenir.
On ne se passionne à propos des gens que pour les quitter bruyamment.
Nous nous sommes longtemps employés à
obtenir des bouteilles vides, à partir de pleines. La grève générale
s’est pourrie en trois semaines ; la reprise du travail marque une
défaite de plus pour la Révolution en France. J’aurai vingt-deux ans
dans trois mois. Perdre son temps. Gagner sa vie. Toutes les dérisions
du vocabulaire. Et des promesses. Nous nous reverrons. Vous parlez.
Et Vincent Van Gogh dans son CAFÉ DE NUIT
avec le vent fou dans les oreilles. Et Pascin qui s’est tué en disant
qu’il avait voulu fonder une société de princes, mais que le quorum ne
serait pas atteint. Et toi, écolière perdue ; ta belle, ta triste
jeunesse ; et les neiges d’Aubervilliers.
L’univers en cours d’éclatement. Et nous
allions d’un bar à l’autre en donnant la main à diverses petites filles
périssables comme les stupéfiants dont naturellement nous abusions. Tout
cela n’était que relativement drôle.
Mais que deviendra-t-elle dans tous
les ports illuminés de l’été, dans tous les abandons du monde, dans le
vieillissement du monde ?
ON S’EN SOUVIENDRA DE CETTE PLANÈTE. Si peu. Passons maintenant aux choses sérieuses.
*
Notre temps voit mourir l’Esthétique.
« Les arts commencent, s’élargissent et
disparaissent, parce que des hommes insatisfaits dépassent le monde des
expressions officielles, et les festivals de sa pauvreté. » (Hurlements en faveur de Sade. Juin 52.)
Depuis un siècle toute démarche
artistique part d’une réflexion sur sa matière, aboutit à une réduction
plus extrême de ses moyens (explosion finale du mot, ou de l’objet
pictural. Le Cinéma a suivi le même processus, accéléré par le précédent
des arts plus anciens).
L’isolement de quelques mots de Mallarmé
sur le blanc dominant d’une page, la fuite qui souligne l’œuvre
météorique de Rimbaud, la désertion éperdue d’Arthur Cravan à travers
les continents, ou l’aboutissement du Dadaïsme dans la partie d’Échecs
de Marcel Duchamp sont les étapes d’une même négation dont il nous
appartient aujourd’hui de déposer le bilan.
L’Esthétique, comme la Religion, pourra
mettre longtemps à se décomposer. Mais les survivances n’ont pas
d’intérêt. Nous devons simplement dénoncer l’espoir qui pourrait encore
être placé dans ces solutions rétrogrades, et c’est le sens de notre manifestation contre Chaplin, en octobre 52.
L’Art Moderne pressent et réclame un
au-delà de l’Esthétique, dont ses dernières variations formelles ne font
qu’annoncer la venue. À cet égard l’importance du Surréalisme est
d’avoir considéré la Poésie comme simple moyen d’approche d’une vie
cachée et plus valable. Mais le matin ne garde que peu de traces des
constructions oniriques inachevées. Les années passent bourgeoisement en
attendant du « hasard objectif » d’improbables passantes, d’incertaines
révélations.
Deux générations ne peuvent pas vivre sur le même stock d’illusions.
Le Lettrisme d’Isou a été une sorte de Dadaïsme en positif.
Il propose une création illimitée d’arts nouveaux, sur des mécanismes
admis. Dans l’inflation des valeurs expliquées, le dernier intérêt qui
restait à ces disciplines s’en détache.
Les arts s’achèvent dans leurs dernières richesses, ou continuent pour le commerce.
« On créera chaque jour des formes
nouvelles ; on ne se donnera plus la peine de les prouver, d’expliciter
leur résistance par des œuvres valables… On ira plus loin afin de découvrir d’autres sources séculaires
qu’on abandonnera, à leur tour, dans le même état de virtualité
inexploitée. Le monde dégorgera de richesses esthétiques dont on ne
saura quoi faire. » (Isou. Mémoire sur les forces futures des arts plastiques et sur leur mort. Mars 51.)
Après le procès de cet académisme idéaliste, et l’exclusion de ses tenants, j’écrivais :
« Tous les arts sont des jeux vulgaires, et qui ne changent rien. » (Notice pour la Fédération française des ciné-clubs. Novembre 52.)
Notre mépris pour l’Esthétique n’est pas
choisi. Au contraire, nous étions plutôt doués pour « aimer ça ». Nous
sommes arrivés à la fin. Voilà tout.
À la limite de l’Expression, que nous
considérons dès maintenant comme une activité secondaire, les dernières
formees découvertes participent à la fois d’une conscience claire de
l’extrême usure de l’idée de communication, et d’une volonté
d’intervention dans l’existence.
« Il voulait rénover l’amour par une technique filmique nouvelle. » (Gil J Wolman. L’Anticoncept. Février 52.)
Le Cinéma anticonceptuel de
Wolman parvient à une œuvre muable par chaque réaction individuelle, au
moyen d’une ambiance visuelle et d’un jeu vocal sans rapport avec le
récit. L’Art avance alors, d’une forme donnée, vers un jeu en
participation.
J’ai utilisé dans le film intitulé Hurlements en faveur de Sade (entreprise de terrorisme cinématographique) une majorité de phrases détournées : articles du Code civil, conversations anodines, ou citations d’auteurs connus, qui prennent une autre signification par leur mise en présence.
Le détournement des phrases est la première manifestation des arts d’accompagnement soumis à un autre but, dans lesquels nous voyons la seule utilisation du passé définitivement clos de l’Esthétique.
Dans la même direction Gaëtan M. Langlais a écrit Jolie Cousette
avec diverses coupures de presse d’origine quelconque. Le non-rapport
ne peut pas exister. Comme dans le rapprochement arbitraire d’une photo
et d’un texte (illustration photographique des numéros 1 et 3 de l’Internationale lettriste) la juxtaposition de deux phrases crée forcément un nouvel ensemble, impose toujours une explication.
Le roman quadridimensionnel de Gilles
Ivain « se passera dans une vingtaine d’ouvrages déjà publiés… Il
débordera des cadres du FAIT littéraire pour envahir et modifier
violemment la vie par tous les moyens dont le plus simple sera à l’image
du phénomène d’induction magnétique. Le roman sera un corpus
quadridimensionnel de signes gravés et d’images-clefs. Le roman
ébauchera de nouvelles mathématiques de situations ou ne sera pas. » (Gillespie. À paraître aux éditions Julliard.)
*
Notre action dans les arts n’est que
l’ébauche d’une souveraineté que nous voulons avoir sur nos aventures,
livrées à des hasards communs.
Ces œuvres en marche sont seulement des recherches pour une action directe dans la vie quotidienne.
Dans un univers pragmatique, l’intention profonde de l’Esthétique a été bien moins de survivre que de vivre absolument.
Avec nous vraiment « la poésie doit avoir pour but la vérité pratique ».
Le même souci d’investir les êtres et leurs cheminements domine toute cette fin de l’Esthétique, de la proclamation initiale de Wolman : « La nouvelle génération ne laissera plus rien au hasard » à la métagraphie influentielle de Gilles Ivain.
*
Le Décor nous comble et nous détermine.
Même dans l’état actuel assez lamentable des constructions des villes,
il est généralement très au-dessus des actes qu’il contient, actes
enfermés dans les lignes imbéciles des morales et des efficacités
primaires.
IL FAUT ABOUTIR À UN DÉPAYSEMENT PAR
L’URBANISME, à un urbanisme non utilitaire, ou plus exactement conçu en
fonction d’une autre utilisation.
La construction de cadres nouveaux est la condition première d’autres attitudes, d’autres compréhensions du monde.
Le même désir suit son cours souterrain
dans plusieurs siècles d’efforts libérateurs, depuis les châteaux
inaccessibles décrits par Sade jusqu’aux allusions des surréalistes à
ces maisons compliquées de longs corridors assombris qu’ils auraient
souhaité d’habiter.
Le charme — au sens le plus fort — que
continuent d’exercer les grands châteaux du passé, les villages cernés
de palissades des beaux temps du Far West, les maisons inquiétantes du
port de Londres — caves communiquant avec la Tamise — ou les dédales des
temples de l’Inde ne doit pas être abandonné à une faible évocation
périodique dans les cinémas, mais utilisé dans des constructions
nouvelles concrètes.
Le prestige des Enfants terribles
sur toute une génération tient finalement au climat créé par une
construction inusitée d’un lieu, et le parti pris d’y vivre exlusivement
: une chambre abstraite, une ville chinoise aux murailles de paravents.
« Une seule chambre île déserte entourée de linoléum » (page 163). Une
phrase du livre révèle clairement toutes les chances d’aventures
contenues dans une maison, à la suite d’une « erreur » dans les plans
classiques de l’architecture : « Ils avaient remarqué une de ses vertus,
et non la moindre : la galerie dérivait en tous sens, comme un navire
amarré sur une seule ancre. Lorsqu’on se retrouvait dans n’importe
quelle autre pièce, il devenait impossible de la situer et, lorsqu’on y
pénétrait, de se rendre compte de sa position par rapport aux autres
pièces » (page 159).
La nouvelle architecture doit tout conditionner :
Une nouvelle conception de l’ameublement,
de l’espace et de la décoration pour chaque pièce. Une nouvelle
utilisation des sensations thermiques, des odeurs, du silence et de la
stéréophonie. Une nouvelle image de la Maison (escaliers, caves,
couloirs, ouvertures) qui va être étendue à la notion de complexe architectural,
unité plus large que la maison actuelle, et qui sera la réunion de tous
les bâtiments — nettement séparés de l’extérieur — contribuant à créer
un climat, ou un heurt de plusieurs climats.
Parvenant alors à l’utilisation des autres arts, pris à n’importe lequel de leurs stades passés comme objets pratiques d’accompagnement, l’architecture redeviendra cette synthèse directrice des arts qui marquait les grandes époques de l’Esthétique.
Tous les exemples déjà en vue pour ces complexes
introduisent de toute évidence une architecture baroque, à la fois
contre le genre « présentation harmonieuse des formes » et contre le
genre « maximum de confort pour tous ».
(Qu’est-ce que M. Le Corbusier soupçonne des besoins des hommes ?)
L’Architecture en tant qu’art n’existe qu’en s’évadant de sa notion utilitaire de base : l’Habitat.
Il est assez symptomatique de constater
que dans cette discipline, dont tant d’œuvres ont été limitées par une
intention utilitaire (buidings géants pour loger le plus de monde
possible ou cathédrales pour prier), la direction à la fois gratuite et
influentielle dont je parle est annoncée depuis quelque temps par le
merveilleux PALAIS IDÉAL du facteur Cheval, certainement plus important
que le Parthénon et Notre-Dame réunis ; et par les réalisations
étonnantes que permet le dernier point de la technique du matériau :
murs en air comprimé, toits en verre, etc.
L’apparition récente en Amérique de
maisons intimement mêlées à la végétation environnante va aussi dans le
sens prévisible de notre urbanisme qui sera une juxtaposition déroutante
de la nature à l’état sauvage et des complexes architecturaux les plus
raffinés, dans les quartiers centraux des villes.
Cet effort pourra se développer dans deux
voies parallèles : création de villes dans les conditions géographiques
et climatiques les plus favorables. Arrangement des villes
préexistantes et dont certaines, comme Paris, permettent de pressentir
beaucoup de cet avenir. (Des lieux comme la place Dauphine ou la cour de
Rohan constituent une base très attirante pour un complexe
architectural.) L’Urbanisme nouveau devra intégrer les formes des
constructions anciennes, et en bâtir d’absolument inédites.
Les quartiers des villes permettront par
leur diversité et leur opposition (cf. le projet de Gilles Ivain pour
des quartiers-états d’âme) de voyager longtemps dans une seule
agglomération, sans l’épuiser mais en s’y découvrant.
L’Urbanisme envisagé comme moyen de
connaissance s’annexera tous les domaines mineurs qui cessent en ce
moment de nous préoccuper en eux-mêmes. Il utilisera à la fois le
dernier état des arts plastiques pour décorer ses rues, ses places, ses
terrains vagues, ses forêts soudaines — et les résultats de la Poésie
délaissée pour les nommer (Allée Jack l’Éventreur. Quartier Noble et
Tragique. Rue des Châteaux de Louis II de Bavière. Impasse du Chien
Andalou. Palais de Gilles de Rais. Rue Barrée. Chemin de la Drogue). Il
fera le meilleur emploi des lumières par les fenêtres, des rues
totalement noires, des rivières dissimulées et des labyrinthes ouverts
la nuit.
L’avenir est, si l’on veut, dans des Luna-Park bâtis par de très grands poètes.
Pour reprendre le cas des villes
actuelles, plusieurs quartiers peuvent être très rapidement détournés de
leur usage. À Paris l’île Saint-Louis peut être gardée comme elle est
mais en faisant sauter les ponts, et peuplée en tout d’une vingtaine
d’habitants, nomades parmi tous les appartements déserts. Quelques
anachronismes somptuaires d’aujourd’hui coûtent plus cher.
Encore plus vite fait, on peut utiliser
certaines surprenantes réclames au néon comme : ABATTOIRS, AVORTEMENTS,
RESTAURANT TRÈS MAUVAIS.
Car pourquoi l’humour serait-il exclu ?
Il va de soi que ces villes s’étendront avec l’évolution de la condition actuelle de l’Homme, utilisé et salarié.
*
Le Destin est Économique. Le sort des
hommes, leurs désirs, leurs « devoirs » ont été entièrement conditionnés
par une question de subsistance.
L’évolution machiniste et la
multiplication des valeurs produites vont permettre de nouvelles
conditions de comportement, et les réclament dès maintenant, alors que
le problème des loisirs commence à se poser avec une urgence sensible à tout le monde. L’organisation des loisirs, pour une foule qui est un peu moins
astreinte à un travail ininterrompu, est déjà une nécessité d’État ;
même quand ces gens se contentent des divertissements du type Parc des
Princes, pour leurs sinistres dimanches.
Après quelques années passées à ne rien faire au sens commun du terme, nous pouvons parler de notre attitude sociale d’avant-garde,
parce que dans une société encore provisoirement fondée sur la
production, nous n’avons voulu nous préoccuper sérieusement que des
loisirs.
Persuadés que les seules questions
importantes de l’avenir concerneront le JEU, à mesure que la
désaffection pour les valeurs absolues des morales et des gestes ira
croissant, nous avons joué dans cette attente à travers les rues pauvres
des faits permis ; dans les bosquets de briques du quai Saint-Bernard
dont nous refaisions la forêt.
Mais en appliquant à ces faits de
nouvelles intentions de recherches — une méthode dont le discours n’est
pas encore écrit — on pourra en déduire les lois, vaguement pressenties,
des seules constructions qui en définitive nous importent : DES
SITUATIONS BOULEVERSANTES DE TOUS LES INSTANTS.
L’Internationale lettriste publiait en février 53 un tract dont toute l’aggressivité désespérée se justifiait dans sa dernière phrase :
« Les rapports humains doivent avoir la passion pour fondement, sinon la Terreur. »
Cette passion qu’il est tout de même
difficile de trouver dans nos « fréquentations » (nous savons de quoi
ces choses-là sont faites, comme disait terriblement Jacques Rigaut),
nous voulons la situer dans le renouvellement constant du monde ; où des
inconnus se rencontreraient partout, s’en iraient sans jamais y croire,
simplement parmi le tragique et les merveilles de leur promenade
terrestre.
« Toutes les filles arborescentes de la
rue ont un passé alors quand serons-nous libres des vierges perpétuelles
sans mémoire et qui ne parlent pas. » (Gil J Wolman. L’Anticoncept.)
Ce désir d’une vie plus vraie, simplement jouée, est contemporain d’une perte d’importance des sujets classiques de passion.
« Nous aurons déterminé des jeux nouveaux
et leur avenir avant que vous n’ayez atteint l’âge de pleurer
sérieusement pour de petites choses. » (Première lettre à Missoum, sur le détournement des mineures.)
À ce dépassement fait écho la définition de Gilles Ivain :
« Le continent choisi comme jouet. »
(Récemment Gil J Wolman me rappelait que
je lui avait avoué autrefois : « Je n’ai jamais su que jouer. » Je crois
que cette vérité devra être, après tous les trucages également inutiles
de l’affection ou de l’hostilité, le dernier jugement sur mon compte.)
*
Épars dans le siècle, des signes d’un
nouveau comportement se manifestent. Ils crient dans le fracas. EN MARGE
de l’Histoire, de ces bombes qu’ont jetées les petites nihilistes
russes pendues à quinze ans ; ou dans le récit fermé des Enfants terribles et leur inceste inaccompli, ou dans la façon émouvante et burlesque de vivre de quelques personnes que j’ai bien connues.
Il faut établir une description complète de ces comportements et parvenir jusqu’à leurs lois.
La piste d’une vie gratuite a été
plusieurs fois relevée, et des voyageurs pressés l’ont suivie sans en
revenir — comme Jacques Vaché qui écrivait : « mon but actuel est de
porter une chemise rouge, un foulard
(LA SUITE MANQUE)
Rédigé par Guy Debord en septembre 1953, le Manifeste pour une construction de situations,
inédit, est composé de onze feuillets dactylographiés portant en tête
l’inscription : « Exemplaire spécialement corrigé à l’intention de Gil J
Wolman, G E ».