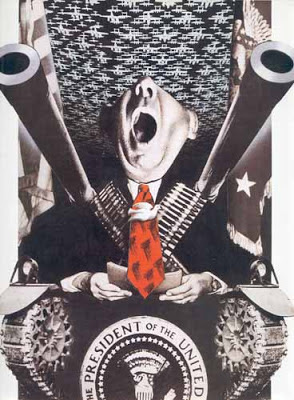SOURCE: https://carlosgarrido.substack.com/p/trump-as-todays-fdr?utm_source=post-email-title&publication_id=2220396&post_id=159689987&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=4aiktl&triedRedirect=true&utm_medium=email
Carlos L. Garrido: cet article est une version étendue de celle qui est parue dans l'Académie chinoise le mois
dernier. Le mois du recul a, à mon avis, confirmé les préoccupations
que j’avais exprimées au sujet de l’apparente « démontage » de
l’administration Trump des institutions de l’impérialisme américain.
Loin de voir toute véritable attaque contre les institutions de
l’empire, nous voyons une restructuration – un empire prenant une
nouvelle forme pour soutenir une hégémonie décroissante. Pour cette «
nouvelle forme », les institutions de réveil, l’impérialisme humanitaire
du passé (USAID, NED, etc.) sont peu utiles.
L'histoire nous enseigne que les empires ne peuvent jamais
affirmer explicitement les véritables raisons de leurs activités
impériales. Il est impossible d'obtenir une population de personnes
dépossédées pour aider à envoyer leurs enfants en guerre lorsque vous
êtes ouvert au sujet de la classe de personnes qui en bénéficient.
C’était Platon dans sa république qui avait déjà
noté que les États dont le fondement économique est fondé sur «
l’acquisition sans fin de monnaie », trouvent qu’ils doivent « saisir
une partie des terres de leur voisin ». Cette dynamique économique
conduit inévitablement à la guerre. Et « quand les riches font la guerre
», comme l’a dit Jean-Paul Sartre, « ce sont les pauvres qui meurent ».
Cela est vrai pour toutes les sociétés qui ont été fragilisées par
classe. Il y a toujours une classe de gens qui fait le profit, et une
classe qui fait la mort, en temps de guerre.
Les élites au
pouvoir des États belligérants n'ont jamais été en mesure d'annoncer
explicitement les raisons économiques de la guerre. La légitimation de
la guerre a toujours dû inclure une tromperie du grand public. Aschyle
avait raison de dire que « en guerre, la vérité est la première victime
». Le respect de la guerre exigeait toujours un récit qui peut être
conçu pour fabriquer le consentement des gouvernés.
Les Grecs de
l'Antiquité et l'empire britannique ont justifié les efforts de guerre
et la colonisation par des appels nobles, presque humanitaires, à des
appels à la civilisation des barbares. Ceux qui étaient de leur espèce
sont toujours ceux qui sont pleinement humains. Et ceux qui n'ont pas
porté la odeur de l'altérité barbare sur eux. De l'hellénisation à
l'empire où le soleil ne se couche jamais, la guerre coloniale est
elle-même présentée comme un acte de charité et de bonne volonté. Vous
devriez être reconnaissants que nous avons dépensé nos précieuses
ressources « civilisées » par vous.
Paradoxalement, les guerres
expansionnistes ont aussi souvent pris la forme d'une entreprise
défensive. L'Empire romain a souvent eu recours à la nécessité de se
protéger contre les menaces extérieures barbares pour justifier
l'expansion. L'offensive est souvent présentée comme la meilleure forme
de défense. C'est en conquérant que nous pouvons garder notre peuple à
la sécurité à la maison. Pendant les guerres puniques, par exemple,
l'expansion coloniale a été légitimée en tant que tentative de contrer
la menace carthaginoise.
La légitimation idéologique de la guerre du moins si-cendres au XXe thsiècle
a pris la même forme. Il s'agissait de pillages impériaux et de
conquêtes justifiées par leur présentation de mesures défensives visant à
empêcher la propagation du communisme. L'offensive a de nouveau été
déguisée comme défense.
À l'époque moderne, nous avons
assisté à une combinaison cohérente des deux par l'empire américain,
bien qu'à n'importe quel moment, il puisse être soit «
l'offense-comme-défense » soit la « conquête humanitaire » qui pourrait
prendre la domination sur l'autre.
Par exemple, pendant la
guerre en Irak, le modèle qui s'est avéré le plus efficace. Oui, nous
avions encore un contingent du modèle de justification de la « conquête
humanitaire » qui appelait la nécessité d'« aider les femmes opprimées »
ou d'« apporter la démocratie » dans la région. Mais cela a finalement
joué un rôle secondaire à la peur du « autre » brun, musulman, que la
classe dirigeante ait pu infuser dans la population, en particulier
après le 11 septembre. Cette crainte était essentielle pour le modèle de
légitimation de l'infraction de défense. Comme Bush l'a dit dans le
discours de West Point le 1er juin 2002, « Si
nous attendons que les menaces se concrétisent, nous aurons attendu trop
longtemps. Nous devons prendre la bataille contre l'ennemi, perturber
ses plans et faire face aux pires menaces avant qu'ils n'ément n'ément. »
La
domination du modèle de l'offensive comme défense a laissé un mauvais
goût dans la bouche des Américains, qui sont venus à temps pour s'opposer
à l'unanimité la guerre en Irak, réalisant qu'il s'agissait d'une
guerre pour le pétrole et le contrôle des marchés pétroliers, pour ne
pas nous défendre contre les dangers fabriqués de la destruction des
armes de destruction massive.
Cela a permis à la classe dirigeante
de pivoter vers le modèle humanitaire car la forme clé de la
légitimation pour la guerre prendra. Assad a dû être renversé parce
qu’il « gazait son peuple ». Cuba a dû être renversée parce qu'elle
réprimait les « artistes noirs » du mouvement San Isidro financé par
Miami. Le Venezuela a dû être renversé parce que Maduro était un
dictateur brutal qui opprimait les LGBTQ, la même chose avec l'Iran, la
Russie, etc. La Chine a dû être renversée parce qu'elle produisait un «
génocide » de la minorité musulmane ouïghoure. Bien sûr, on n'a jamais
fourni de preuves réelles de l'une quelconque des accusations, comme les
« preuves » des armes de destruction massive.
De plus en plus, la forme spécifique adoptée par le modèle de conquête humanitaire a été le réveil. Le théoricien politique Marius Trotter l'a bien dit il y a quelques années quand il a dit :
«
Face à une Chine en pleine montée et à une Russie résurgente, la classe
dirigeante américaine a besoin d’une croisade moralisante pour motiver
son contre-offensive contre ses ennemis, tant dans le pays qu’à
l’étranger. Sous les bannières de Black Lives Matter, des drapeaux de la
Fierté multicolores et des trompettes annonçant les bons pronoms de
genre, les canons de l'Empire américain répandront le credo de Woke
Imperialism ».
Mais
comme le wokisme lui-même a été étendu à des extrêmes aussi absurdes
qu'aucune personne saine d'esprit ne pouvait accepter, il est rapidement
devenu sanctuaire comme modèle de légitimation de la guerre. Personne
ne se soucie d'aller à la guerre pour les droits des transsexuels battus
par l'USAID dans les pays de l'Est. Personne n'adhère vraiment dans le
récit sans fondement que les États-Unis, qui ont passé les 20 premières
années du siècle à bombarder des musulmans, tuant des millions d'entre
eux, se soucient maintenant d'eux au Xinjiang. Et où était la preuve que
quelque chose se passait en premier lieu ? Comme l'a fait valoir le
philosophe cubain Ruben Zardoya, lorsque les machinations de domination
deviennent transparentes, la domination elle-même s'affaiblit. C'est ce
qui s'est produit à la forme de légitimation impériale, et pour éviter
l'affaiblissement du pouvoir impérial et de la domination, la classe
dirigeante a dû changer de cap.
Quand la conscience des gens
hors-la-loi est hors du modèle éveil de l'impérialisme, la classe
dirigeante a besoin d'une liste propre. Trump et ses cohortes de faux
droitistes dissidents, qui mènent une croisade anti-fou, étaient
l’alternative parfaite. À une époque où le peuple américain veut être
dissident et anti-establishment, donne-lui le même statu quo, mais sous
la forme d'une dissidence. Donnez-leur des gens qui luttent contre la forme que revêt
l’idéologie impérialiste ces dernières années, mais pas contre
l’impérialisme lui-même – pas contre le système qui l’a produit en
premier lieu.
Comme Jackson Hinkle et Haz Al-Din l'ont déjà
noté, nous ne devrions pas être surpris si l'intensification des
absurdités du wokisme était intentionnellement conçue pour soutenir un «
droit dissident » qui n'est « dissident » que pour les composantes les
plus superficielles et les plus profondes de l'ordre de la décision.
J'ai
déjà soutenu qu'il s'agit d'une époque, aux États-Unis, marquée par la
nécessité de l'hégémonie se présenter comme contre-hégémonique. Les
dirigeants doivent, à tout moment, manipuler le public pour les voir
comme subalternes, impuissants et mener une croisade contre les élites
elles-mêmes. Des conservateurs aux libéraux, aux différents « gauchers »
trotskistes et « socialistes démocratiques », toute la politique
américaine prend de plus en plus la forme de dissidence. C'est une
aristocratie du capital qui survit à travers la perspective de se battre
continuellement contre lui-même pour le pouvoir. Comme dans The Trial de Kafka,
où la bureaucratie de la cour est reproduite précisément en se
présentant comme des sujets impuissants subjugués par le système, la
dialectique de l'autorité politique américaine aujourd'hui prend
également la forme de cette feintesse pour soutenir leur omnipotence
systémique. Le pouvoir se maintient par le prétexte de l'impuissance.
Et
maintenant nous sommes ici. Dans une présidence de Trump qui démantèle
l’USAID – l’un des hommes de main misérables de « l’impérialisme
humanitaire » – et qui s’oriente vers des attaques impérialistes
impérialistes, qui s’oriente peut-être vers la bonne volonté pour la
démocratie et de nombreuses autres institutions liées à la forme moderne
de légitimation et de réalisation d’agressions impérialistes.
Je
voudrais penser qu'il s'agit d'une révolution contre un État exaltante
qui aspire le sécher de la république hôte, comme l'a suggéré Scott
Ritter. J'espère vraiment que ce pourrait être cela, et que le jubilé de
la dette que Ritter prétend être possible avec cette « révolution » se
déchaîne. 1
Philosophie partagée en crise
Mais
mon bon sens marxiste, ma compréhension des formes toujours en
évolution de l'impérialisme américain qui justifie idéologiquement
m'indique que, peut-être, quelque chose d'autre est en train de se
passer : un retour à une précédente forme de légitimation. 2
Peut-être
un retour à la domination du modèle d'offensive en tant que défense que
nous avons vu dans la guerre froide et au cours des premières décennies
de ce siècle. Celui-ci semble certainement dominer dans le discours
autour de la Chine, qui est présenté comme une « menace existentielle »
pour la sécurité et la position géopolitique des États-Unis. Le
conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Waltz, a déclaré
que « nous sommes dans une guerre froide avec le Parti communiste
chinois » et que la Chine est une « menace existentielle pour les
États-Unis avec le renforcement militaire le plus rapide depuis les
années 1930 ». Ce discours sur la Chine en tant que menace
existentielle, qui est très courante dans la création de la politique
étrangère, est fondamental pour le modèle d'offensive de défense de
l'impérialisme.
Certains analystes ont suggéré un retour à un
impériaalisme de style Monroe Doctrine, où l'on est plus ouvert sur les
objectifs de conquête pour la conquête, voilé à peine avec un appel à un
mandat divin. C'est une autre forme que nous avons vue dans l'histoire
des empires. Il est clair que ce modèle de discours est utilisé dans la
rhétorique utilisée pour la politique étrangère des États-Unis dans
l'hémisphère occidental.
La vérité, cependant, c'est que nous ne savons pas. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe réellement.
Cette
indétermination n'est pas seulement dans notre connaissance de la
situation actuelle. Je ne pense pas que le problème, pour le moment,
soit un problème qui se situe dans notre connaissance du monde, de la
façon dont l'impérialisme américain se développera dans les années à
venir. L'indétermination est dans le monde lui-même. Le régime américain
est lui-même à la dépouille pour comprendre ses prochaines mesures,
pour voir ce qu'il peut faire pour soutenir au moins un semblant
d'hégémonie dans un monde où le Weltgeist se déplace vers l'est.
Nous
pouvons dire aujourd'hui de cette indétermination la même chose que
Hegel a répondu au dilemme de Kant concernant le « fossé » entre notre
savoir phénoménal et la chose en soi (Ding un sich)
: il n'y a rien de soi qui n'est déjà une chose pour nous. Le fossé
n'est pas entre mes connaissances et le monde; le fossé est dans le
monde lui-même. C’est « l’incomplétude qu’ontologique la réalité »,
comme l’appelle Slavoj ziek, que nous traitons ici, et pas simplement
une incomplétude de nos connaissances. Traiter le contraire -
c'est-à-dire s'accrocher à l'idée que les événements mondiaux sont déjà
déterminés, que le problème est de nature épistémologique - est de
suivre la même abstraction que Hegel a critiquée dans Kant. Tout comme
la « chose en soi », qui n'est pas toujours prête (comme le dirait
Heidegger) une chose pour nous, n'est rien de plus qu'une « abstraction
vide » kantienne, en maintenant que les impérialistes d'aujourd'hui ont
un ordre du jour clairement déterminé et cartographié, et que ce qui
nous empêche de le savoir définitivement est une limitation dans notre
compréhension, c'est de se déplacer au même niveau.
Cela
confère à ces institutions un pouvoir mystique qui n'est pas
nécessairement là, qui ressemble plus étroitement aux films
hollywoodiens sur la CIA que la situation réelle. Ils aussi, face à la
crise actuelle, essaient de s'orienter dans le monde, en essayant de
concevoir de nouveaux moyens par lesquels leur pillage de la planète
peut se poursuivre sans être remis en question.
Ce que je pense
que nous pourrions être les plus sûrs, ce sont les suivants : ce n'est
pas une révolution anti-impérialiste qui se produit dans le ventre de la
bête par la main des milliardaires eux-mêmes. Lorsque certains des
principaux milliardaires, des ONG, des groupes de réflexion et des
entreprises d’investissement financier sont parfaitement, ou même
favorables, de l’administration Trump, cela n’inspire pas confiance dans
la thèse selon laquelle il intente une grande attaque contre le
système. Après tout, si quelqu'un incarne le mieux le système, ce sont
ces profiteurs qui ont continué à gagner de l'argent, quel que soit
celui qui a été à la Maison Blanche. Ils composent le corps non élu de
dirigeants qui reste le même avec tous les changements d'administration.
Avec l’agence de renseignement qui sert leurs intérêts, ils forment le
fameux « Deep State ». Quand le PDG de BlackRock, Larry Fink, nous dit,
comme il l'a fait pendant les campagnes présidentielles, qu'il est «
fatigué d'entendre que c'est la plus grande élection de votre vivant »,
et que « la réalité est dans le temps, peu importe », peut-être
devrions-nous écouter.
Au lieu d'une attaque contre le
système impérialiste et l'État profond, il est beaucoup plus probable
qu'il s'agit d'un pivot vers une nouvelle forme de gouvernance
impérialiste et de légitimation. Tout comme le capitalisme américain
avait besoin de prendre une nouvelle forme après la grande dépression
pour survivre, dans cette grande crise de l'Empire, les États-Unis
doivent faire de même. Trump est donc ici, un chiffre homologue à
Franklin D. Roosevelt (FDR). Le FDR rompt avec les orthodoxies des
idéologues de l'économie de marché pour sauver le capitalisme. Il a
rompu avec la forme que le système avait
jusqu'alors prise pour le maintenir en vie. Peut-être Trump, de même,
est-il un chiffre qui aspire à aider à sauver l'impérialisme américain
par l'assaut contre l'orthodoxie et les institutions qui l'ont amené au
bord de l'effondrement.
C'est ce que la brillante
maîtrise des États, visant à soutenir l'hégémonie des États-Unis à long
terme, ferait pour essayer de sauver l'empire de ce déclin. Après tout,
comme Giuseppe Tomasi di Lampedusa l'a écrit dans son roman, Le Léopard, les choses doivent changer pour qu'elles puissent rester les mêmes.
Bien que j'espère me tromper, je pense que c'est le type de changement que nous voyons. Une modification d'une nouvelle forme de légitimation, nécessaire pour maintenir la base essentielle de l'impérialisme américain.
[1]Pour
être juste avec Scott, il s’est déclaré de plus en plus critique à
l’égard des actions de Trump au Moyen-Orient depuis la publication
initiale de cet article. Dans un tweet, la journée de rebut du
bombardement du Yémen, Scott a déclaré :
« Et dans une nuit de mégalomanie narcissique, Donald Trump a abandonné
le titre de pacificateur, l’échangeant contre un fauteur de
requin-bassins, et s’est mis sur la voie de devenir le plus grand
perdant de l’Amérique. L'Amérique ne peut plus être « grande » quand le
prix du pétrole passe par le toit. Et le début d’une guerre avec l’Iran
restera dans l’histoire comme l’une des pires blessures auto-infligées
qu’un président américain jamais commis. » Cependant, même en ce qui
concerne la guerre en Ukraine, les mesures prises par Trump ont été des
demi-pas. Il n'y a pas eu de tentative sérieuse d'arrêter le régime
zelensky. Ici, la perspective donnée par le colonel Douglas Macgregor est, à mon avis, beaucoup plus correcte.
[2]Après avoir publié une version abrégée de cet article pour The China Academy,
un camarade appelé par l'attention sur une vidéo que Brian Berletic
avait faite sur le sujet, où il a présenté une analogie extrêmement
utile pour capturer ce que j'avais en tête en écrivant cet article.
Pensez à un seigneur de guerre qui est sorti pillé diverses régions,
ajoutant dans chaque aventurerie filiale d'escrime ses ennemis tombés à
la sienne. Alors que l'épée a l'air effrayante, les lames vont dans tous
les sens, et ne peuvent donc pas servir à couper quoi que ce soit.
Après cette prise de conscience, le seigneur de la guerre décide de se
débarrasser de toutes les épées supplémentaires et de s'en tenir à sa
tête d'origine. Les villageois infantiles, bien sûr, se répondent et
pensent « enfin, notre cauchemar collectif est terminé ». Après une
inspection plus approfondie, il ne reste plus que la lame d'origine,
qu'il affûme de toute sa force. Bien que l'épée n'ait peut-être pas
l'air aussi effrayante que la précédente, elle est maintenant bien
meilleure pour faire ce que l'épée est censée faire - prendre quelques
crânes. Peut-il s’agir du genre de « démantèlement » que Trump nous a
sous les yeux ?




/image%2F1440064%2F20250911%2Fob_5a0055_dsc00061-scaled.jpg)
/image%2F1440064%2F20240309%2Fob_14c414_arte-sinophobie-02.jpg)
/image%2F1440064%2F20240309%2Fob_da39b4_arte-sinophobie-03.jpg)