Une théologie palestinienne de la libération. Bible et justice dans le conflit israélo-palestinien (publication du livre en 2017, traduction française en 2019) est un ouvrage du prêtre anglican NAïM ATEEK.
Né en 1937, prêtre émérite du Diocèse épiscopalien de
Jérusalem et du Moyen-Orient, il a été expulsé avec sa famille lors de
la création de l’État israélien. Il participe, dans les années 1990, à
la fondation du Centre œcuménique SABEEL (« chemin », « source d’eau
vive » en arabe). Ce mouvement de théologie de la libération travaille à
la base avec les chrétiens palestiniens et tente, à partir d’une pensée
sur la vie de Jésus, de promouvoir la justice et la paix. LES AMIS DE SABEEL – FRANCE,
structure avec laquelle notre collectif est en lien, fait vivre son
message dans notre pays, notamment en traduisant des publications de
SABEEL et en diffusant une prière tous les jeudis.
Cette recension est subjective et nécessairement incomplète.
Elle tente de saisir ce qui est apparu au lecteur comme les points
centraux de la pensée de l’auteur et de les restituer de la façon la
plus accessible possible.
Bien que cet ouvrage soit antérieur à la guerre en cours, il
apporte des éclairages nécessaires à une juste compréhension de la
situation.
Recension réalisée par Foucauld Giuliani
Introduction
L’auteur part de sa situation vécue : « J’ai passé la plus grande
partie de ma vie sous l’injustice et la discrimination du gouvernement
israélien et sous l’oppression qu’il inflige à notre peuple
palestinien. En 1948, j’étais un enfant à Beisan, une ville
palestinienne de 6000 habitants située près du Jourdain. Beisan était
une ville à population mixte, musulmane et chrétienne, avec une
communauté chrétienne dynamique répartie entre trois Eglises : orthodoxe
grecque, catholique romaine et anglicane. (…) Mon père avait une bonne
affaire comme orfèvre travaillant l’or et l’argent. (…) Notre vie a été
bouleversée quand, en mai 1948, les milices sionistes sont entrées à
Beisan pour nous occuper. Beaucoup de gens ont pris peur et se sont
enfuis tandis que d’autres restaient chez eux. Mon père ne voulait pas
partir, il a supplié le commandant militaire de nous permettre de rester
mais les consignes militaires étaient claires : tout le monde devait
partir. C’était un nettoyage ethnique. Nous avons été chassés de nos
maisons manu militari et on nous a donné l’ordre de nous
regrouper au centre de la ville. Les soldats nous ont divisés en deux
groupes : musulman et chrétien. Le premier a été envoyé en Jordanie. (…)
Le deuxième a été mis dans un bus et conduit aux abords de Nazareth où
on les débarqua en dehors des limites de la ville, avec interdiction de
revenir chez eux. (…) À la fin de la guerre de 1948, le nombre de
Palestiniens dépossédés s’élevait à plus de 750.000. En Occident, la
plupart des gens ignoraient cet aspect de la tragédie. Les Arabes
palestiniens étaient en grande partie invisibles aux yeux des
Occidentaux. Ils disparaissaient derrière les victimes de l’Holocauste
dont le sort touchait bien davantage. (…) En fait, beaucoup de chrétiens
occidentaux se sont réjouis de l’établissement de l’État d’Israël. Ils
louaient Dieu pour le retour des Juifs en Palestine. Pour eux, le retour
des Juifs était la preuve de l’accomplissement des prophéties de
l’Ancien Testament et un signe que la fin du monde était proche, et la
seconde venue du Christ imminente. (…) Au lieu de s’indigner devant
l’injustice, les chrétiens se turent et se soumirent. Il ne s’éleva pas
de clameur prophétique, mais ce fut une résignation douloureuse. Les
gens attendaient des chrétiens occidentaux qu’ils défendent leur juste
cause et mettent Israël sous pression pour qu’il respecte le droit
international et permette le retour des réfugiés. Ils n’ont reçu que la
charité, pas la justice. Cela a pris beaucoup d’années avant que la
communauté chrétienne palestinienne soit en mesure de formuler une
nouvelle théologie de la libération. (…) Nous devons œuvrer à la
libération des oppresseurs tout autant qu’à celle des opprimés. »
Le lien est fait entre la situation de souffrance des Palestiniens et
la vie de Jésus : Jésus a été harcelé, de sa naissance (massacre des
Innocents) à sa mort (la crucifixion) par les puissants. Sa parole est
une parole tournée vers tous les exclus de son temps. La plénitude du
Royaume annoncé par le Christ est pour dès à présent et cela implique de
lutter contre ce qui opprime. Il y a une manière chrétienne de lutter
contre l’injustice et l’esclavage, contre les structures profondes qui
produisent ces maux. C’est cela, le travail intellectuel et pratique de
la théologie de la libération.
Chapitre I : La théologie de la libération à l’échelle mondiale
L’auteur s’inscrit dans la tradition de la théologie de la libération
initiée par le théologien péruvien Gustavo Gutierrez et son ouvrage
fondateur (Théologie de la libération, 1971). Cette théologie
vise à mettre en perspective la souffrance et l’injustice subies par les
plus pauvres avec la parole et la vie du Christ, à opérer une critique
des structures de pouvoir oppressives et à accompagner des mobilisations
pour plus de justice.
La théologie de la libération se décline de façon particulière, en
fonction du contexte et des enjeux prioritaires vécus. Ainsi existe-t-il
une théologie de la libération afro-américaine (James Cone, Alice
Walker…), une théologie de la libération noire sud-africaine (Desmond
Tutu, Simone Maimela…), une théologie de la libération féministe
(Marianne Katoppo, Mary Daly…). La théologie de la libération
palestinienne décline la théologie de la libération dans le contexte
d’une conquête et d’une occupation coloniales. Cette théologie ne vise
pas seulement à réaliser, de façon pratique, la libération du peuple
palestinien ; elle vise aussi à « libérer les Écritures » d’une lecture sioniste qui l’emprisonne et la fausse.
La théologie de la libération reconfigure les quatre champs de la
théologie classique : biblique, systématique, pratique et historique.
Ces différents champs prennent un tour nouveau lorsqu’on part de la
conviction que le Christ se confond d’abord avec les plus pauvres et
qu’il offre des ressources pour les aider à comprendre et à améliorer
leur condition.
II : Qui sont les chrétiens palestiniens ?
La théologie de la libération ne prétend pas remplacer les sciences
sociales (histoire, sociologie…). Ainsi est-il central de comprendre les
causes objectives de toute situation collective d’injustice en
parallèle de la pratique d’une approche plus théologique.
Ce chapitre rappelle donc un ensemble de faits historiques : la
grande variété culturelle et religieuse des habitants de Palestine
depuis des milliers d’années ; l’ancestrale présence chrétienne
(majoritaire dès le IVe siècle) ; les controverses
théologiques et les schismes successifs ayant divisé les Églises
chrétiennes ; l’irruption de l’Islam qui eut des effets ambivalents :
tolérance relative, abolition de l’Empire Byzantin qui était un régime
mal accepté mais également phénomène d’apostasie permettant de mieux
s’intégrer dans le régime musulman ; l’impact des Croisades qui ne
considérèrent pas les chrétiens d’Orient comme des alliés et
installèrent à Jérusalem un Patriarche catholique romain ;les missions
protestantes du XIXe siècle qui accompagnèrent la
colonisation ottomane puis européenne ; le projet sioniste qui
considérait l’ensemble des Palestiniens comme des Arables à remplacer
(dès 1895, Herzl parle de « processus d’expropriation ») et qui bénéficia du soutien occidental pour s’implanter.
La naissance d’Israël imposée par les puissances victorieuses de la 2e Guerre
Mondiale eu pour effet de chasser 750.000 Palestiniens de leurs terres
et de diviser par deux le nombre de chrétiens Palestiniens vivant en
Palestine.
Dans ce contexte, la mission de la théologie de la libération palestinienne est plurielle :
– travailler à la réconciliation entre communautés chrétiennes ;
– travailler au dialogue avec les Palestiniens musulmans ;
– militer pour la justice et la paix entre Israéliens et Palestiniens ;
– faciliter une prise de conscience internationale des enjeux du conflit.
III : La triple Nakba
La Nakba (« catastrophe » en arabe) désigne l’implantation
de l’État israélien et son appropriation par la force des terres
palestiniennes. Il y a une triple dimension de cette épreuve : humaine
(millions de réfugiés, déstructuration de la société, traumatismes…) ;
identitaire (déracinement, effacement de la culture…) ; religieuse
(désespoir, perte de confiance en Dieu, doute sur le sens de la foi
chrétienne : « Comment l’Ancien Testament peut-il être parole de
Dieu au regard de l’expérience que font les chrétiens de Palestine en
faveur du sionisme ? »)
IV : Autres raisons de l’émergence d’une théologie palestinienne
La Shoah. Elle a poussé les Occidentaux à offrir aux Juifs une solution, après les horreurs subies. « La Palestine et son peuple ont été sacrifiés sur l’autel de la culpabilité occidentale. » La
naissance d’Israël a été vue, par des millions de Juifs traumatisés,
comme le début de la rédemption et, par des millions de sionistes
chrétiens, comme une étape clé et nécessaire de l’histoire du salut. Les
identités juive et israélienne ont peu à peu fusionné, à tel point
qu’il est presque impossible de faire valoir la différence entre
critique religieuse, haine des Juifs (antisémitisme) et critique de
l’État israélien.
La montée d’un sionisme religieux qui instrumentalise la Bible à son
profit. Celui-ci n’est pas le propre des Juifs, il est aussi diffusé par
des franges du christianisme qui voient le triomphe d’Israël contre les
populations musulmanes arabes comme une étape eschatologique
nécessaire. Imprégné d’antisémitisme (puisque dans ce logiciel au
triomphe d’Israël succède la disparition de la majorité des Juifs), ce
récit joue néanmoins en faveur de l’État israélien et en défaveur des
populations locales arabes.
L’Intifada de 1987. Elle marque un soulèvement du peuple palestinien
et a déclenché les débuts de la théologie de la libération.
Témoignage : « Chaque dimanche, à la cathédrale Saint George de
Jérusalem, siègeait de la communauté anglicane épiscopalienne
palestinienne, la prédication portait sur l’Évangile du jour et traitait
de la situation sur le terrain. Après le culte, la communauté se
réunissait autour d’un café pour réfléchir, à la lumière de l’Évangile, à
leur vie sous l’occupation israélienne illégale. Les gens partageaient
leurs histoires et leurs expériences. Ils se demandaient quel était le
sens de leur foi sous le joug de l’occupation. » Ces temps
conjuguaient la foi dans le Christ libérateur et la quête intérieure et
extérieure de la non-violence ; ils mettaient en valeur l’intelligence
théologique du peuple chrétien, ils étaient des temps collectifs où
chacun pouvait s’exprimer ; ils apportaient réconfort spirituel,
psychologique et lucidité politique ; ils étaient des moments de soutien
mutuel et de fraternité ; ils favorisaient l’identification avec le
Christ, victime lui aussi d’injustice et venu en un temps d’occupation
impériale et coloniale, victime de la collusion de chefs religieux et
politiques.
V : Redonner sa place à l’humanité de Jésus
Une telle théologie entrelace trois niveaux : la foi et la méditation
des textes bibliques, le contexte, la réponse pratique à apporter.
Cette théologie est tendue vers cette question : qu’est-ce que Dieu
attend de nous dans cette situation éprouvante ? Une question souvent
partagée provient du livre biblique de Michée (6, 8) : « Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi ? »
La divinité du Christ ne sépare pas le Christ des hommes, au
contraire ; elle transfigure de l’intérieur l’humanité du Christ qui
vit, souffre et pleure parmi nous. La religion chrétienne cesse alors
d’être une fuite métaphysique pour devenir un lieu d’incarnation
collective véritable.
La théologie de la libération palestinienne est christocentrique.
Elle prend le Christ comme clé herméneutique de nos propres vies. La
Bible se lit à partir du critère de la vie et de la parole du Christ et
non l’inverse. Cette herméneutique qui part de la personne du Christ est
complétée par une herméneutique de l’amour qui perçoit dans l’amour un
outil de connaissance, un mode de perception particulier auquel notre
cœur et notre intelligence doivent se convertir.
Certains passages de l’Évangile portent en profondeur la pratique de
cette théologie. Ainsi de Luc 4, 18-19 qui relaie Isaïe 61 (« L’Esprit du Seigneur est sur moi (…) Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération (…) »)
Ce passage est d’autant plus important qu’en plus d’appeler à la
justice, il résonne comme une dénonciation de l’exclusion et de la
fermeture du cœur, qui rejoint les Palestiniens dans leur souffrance : « Ce
texte est une critique de toute politique ethnocentrique. Les
Palestiniens de la Palestine occupée, tout comme ceux qui sont citoyens
d’Israël, souffrent de discrimination et de racisme. »
VI : Le développement de la pensée religieuse dans l’Ancien Testament
La théologie de la libération palestienne assume une démarche de sélection des textes bibliques de l’Ancien Testament : « Nous
considérons les textes qui ne passent pas la clé herméneutique qu’est
le Christ ou l’amour comme moralement et théologiquement choquants pour
nous. Ils n’ont aucune autorité pour nous. »
Ce constat renvoie à ce qu’on appelle couramment « Textes de terreur ». « Ils sont le reflet d’une conception de Dieu tribale et d’exclusion. » Aux
yeux de Ateek, il est vain d’allégoriser, de spiritualiser, de
rationaliser ou de chercher un sens caché à ces textes. On est proche de
la conception que Simone Weil avait de l’Ancien Testament.
Le Christ « a été très sélectif dans son usage des Écritures ». Nulle mention des Nombres ou encore de Josué et des Juges « qui exaltent le nettoyage ethnique ».
Ateek relève dans ce chapitre de nombreux thèmes (nettoyage ethnique,
anéantissement ethnique, justification de la guerre…) et textes
(Nombres, 33, 50-53…) qui traversent l’Ancien Testament et qui sont
utilisés par des sionistes extrémistes et les colons dans une
perspective ethno-nationaliste. Il y transparaît que Yahvé prend le
visage d’un Dieu de la guerre, vengeur et jaloux. À ces morceaux
bibliques, il convient d’y opposer d’autres (tel que le livre d’Osée qui
déplace le cœur de la foi du sacrifice et de l’obéissance aveugle à
l’amour (6, 6)). Deux traditions théologiques et éthiques se confrontent
tout au long de la Bible.
Une double opération de sacralisation de la terre et de réécriture de
l’histoire (de manière à laisser entendre que le peuple juif est le
seul vrai peuple originaire de cette terre de Palestine) appuie le
sionisme colonisateur dans son entreprise. À cette aune, les
Palestiniens sont mis dans la position de l’étranger et du colonisateur
inversé.
VII : Christ est la clé
Si au temps de Jésus, la question de l’unicité de Dieu est déjà
tranchée, celle de la nature de Dieu reste en suspens : Jésus tranche de
manière définitive pour un Dieu de miséricorde, d’universalité et
d’amour. Face aux scribes (Marc, 12, 28-31), Jésus ne se contente pas
d’avancer la fidélité à Dieu comme plus grand commandement, il y inclut
l’amour du prochain, perçu de valeur équivalente à soi et dont le
périmètre va jusqu’à englober l’étranger et même l’ennemi. Jésus acte
donc la révolution qui était latente chez les prophètes tels que Amos
mais qui n’avait jamais été à ce point explicitée. L’amour du prochain
devient, avec Jésus, le lieu où s’éprouve et se révèle l’amour que nous
portons vraiment à Dieu.
Ateek répertorie et analyse un certain nombre d’exemples tirés des
Évangiles de Luc, Matthieu et Marc dans lesquels s’ébauche un cadre de
relation avec ses compatriotes juifs et avec les non-juifs. Le refus de
l’exclusion et du sectarisme est patent (3 exemples orignaux et moins
courants : Mathieu 2, 1 : des mages étrangers sont les premiers à offrir
des cadeaux à Jésus ; Marc 14, 15 : la prédication du Royaume remplace
celle de la Terre promise au sens territorial, le Royaume est à la fois
déjà là en partie et pour tous sans exception ; Luc 9, 51 : Jésus
réprimande ses disciples qui voulaient appeler le feu du ciel pour
consumer les Samaritains qui refusaient d’accueillir Jésus dans leur
village).
Ateek démontre comment Paul prolonge le message du Christ en
l’interprétant. Notamment sur ces points centraux : exigence
d’universalité, lien étroit foi/charité, déterritorialisation de la
promesse qui porte sur le Royaume et non sur une terre, élargissement du
périmètre de l’élection, subordination du rite à la morale
évangélique.
Il importe de s’arrêter plus en détails sur la question du rapport à
la terre, cruciale dans la période actuelle de la guerre à Gaza : dans
Jean, le vecteur par lequel Dieu montre sa fidélité aux hommes n’est
plus la terre mais le Christ (Jean, 1, 51). En s’appuyant sur les
textes, Ateek opère une transformation du concept de terre : Dieu est le
seul créateur et nous sommes tous des pèlerins, des émigrés, des hôtes
sur la terre ; la doctrine de l’incarnation met l’accent sur l’esprit
comme lieu de sanctification plus que sur la terre ; la terre est à
cultiver et à aimer, ce qui implique aussi de prendre soin de ceux qui y
vivent ; le nationalisme qui sacralise un peuple et sa terre est sans
fondement évangélique, l’horizon spirituel et politique légitime est
l’internationalisme ; l’amour de ses racines et de sa culture ne doit
pas se confondre avec le pouvoir jaloux et exclusif sur sa terre ; les
différences culturelles sont légitimes mais pas les traitements inégaux
par les pouvoirs politiques. Pour finir sur ce point, Ateek cite un
texte de l’Église d’Écosse datée de 2013 : « La “terre promise” de
la Bible n’est pas un espace mais une métaphore de la manière dont les
choses peuvent se passer dans le peuple de Dieu. Cette “terre promise”
peut se trouver et s’édifier partout. »
VIII : La justice : un élément central
Ateek ne croit ni éthiquement ni pragmatiquement au recours à la
violence. En plus d’être en contradiction avec l’Évangile, ce dernier
enferme en effet les Palestiniens dans la figure du « terroriste » et
sert le plaidoyer israélien. Mais que faire face un État, Israël, qui a
plus les allures d’une ethnocratie de plus en plus radicale qu’une
démocratie ?
L’État israélien nie toute forme de colonisation et renverse les
choses en accusant les Palestiniens de le menacer, ce qui lui permet en
retour de justifier ses crimes. On a là des récits mensongers faits par
l’oppresseur pour couvrir ses crimes.
Ateek fait un rappel détaillé des différentes options politiques
classiques et de l’historique des revendications et exigences des
différents acteurs.
Il fait finalement un plaidoyer pour une stratégie de la non-violence. « Au
rayon de la force, nous ne faisons pas le poids. Là où nous sommes de
taille à affronter Israël, c’est dans l’action non-violente. »Ateek plaide pour une formation massive à la non-violence et une action collective massive.
IX : L’émergence de Sabeel et des Amis de Sabeel
Ce chapitre retrace l’histoire et le plaidoyer de Sabeel en faveur de
la paix et de la justice. Un paragraphe traite de Sabeel en France :
l’association est née en France en 2010 sous la direction du pasteur
Gilbert Charbonnier.
X : Le cœur de la foi et de l’action au XXIe siècle
Ce chapitre conclusif affirme que le conflit israélo-palestinien ne
peut se résoudre que dans un ordre précis : justice, paix,
réconciliation. Placer la paix avant la justice, donc avant la fin de
l’oppression coloniale, est une manière de mentir et de défigurer la
paix.
Le livre s’achève en citant un passage d’une prière de Taizé : « Viens, Seigneur, et ouvre en nous les portes de ton Royaume. »
***
Deux agents anti-théologie de la libération à Santiago du Chili en 1987, ils ont déjà bien bossé alors. En 1983, dans sa visite au Nicaragua, Jean-Paul II embrassera le commanditaire de l'assassinat de monseigneur Romero. 



![r/HistoryPorn - Le pape Jean-Paul II avec Augusto Pinochet ; Santiago du Chili, 1987. [389x470]](https://external-preview.redd.it/lqK8c7ito66G0xcBK4Eba3rvstWrf7sV2PcNt6RK-1o.jpg?auto=webp&s=9ddfdb3b8b1a345f03fb4b12b6d130e7ec6193c9)
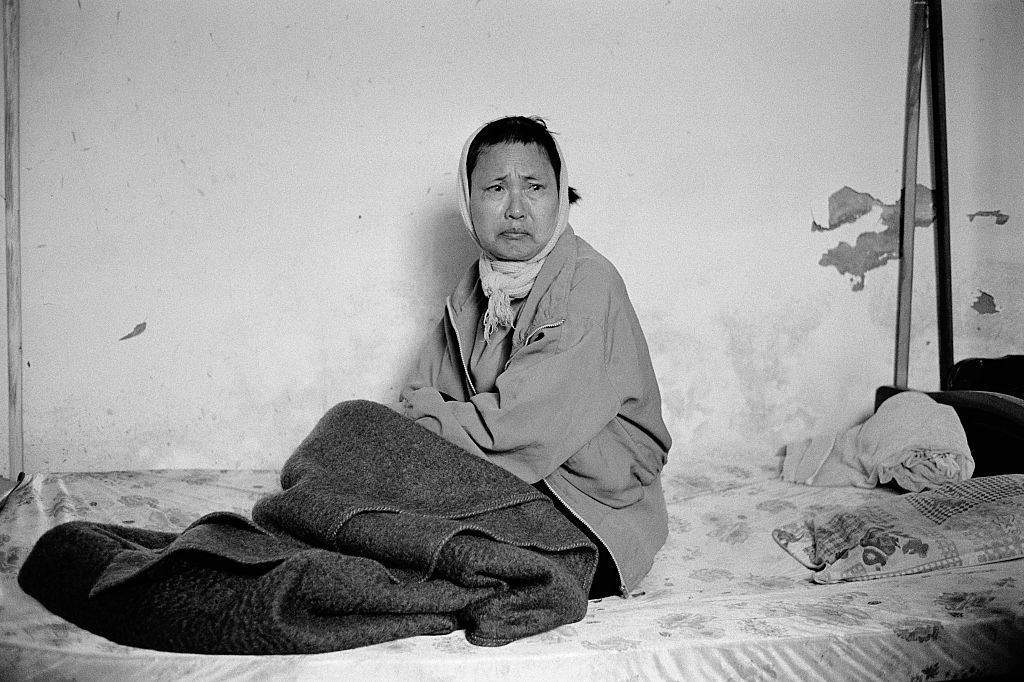


 Le
président américain Carter a signé dès juillet 1979 une directive sur
l'aide aux ennemis du régime soviétique, manœuvre qui visait à piéger
l'URSS en Afghanistan. Officiellement, l'aide de la CIA aux moudjahidin a
commencé en 1980.
Le
président américain Carter a signé dès juillet 1979 une directive sur
l'aide aux ennemis du régime soviétique, manœuvre qui visait à piéger
l'URSS en Afghanistan. Officiellement, l'aide de la CIA aux moudjahidin a
commencé en 1980.
Plus intéressant serait de rappeler les opérations « d’influence » des services américains en France pour contrer le syndicalisme des marxistes , de la CGT qui risquait d’entraver le plan Marshall. La création de Force Ouvrière par exemple par le célèbre trotskiste Kristol (un des inspirateurs du neo conservatisme/libéralisme) d’abord opposé au communisme quoi qu’il en coûte ( Militant trotskiste aux usa il convertit son action en Europe au service des libéraux us) L’ « écueil » ( comme Brezinski nommait la France ) serait peuplé de « gallo communistes » s’inquiètent les américains (et Cohn Bendit ) dont des syndicalistes. L’histoire française de cette ingérence par les services us mériterait un billet svp
Mme Annie Lacroix-Riz
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Annie_Lacroix-Riz ,
a abondament ecrit sur le sujet et bien plus…
Bonne lecture.
« Alors que la libéralisation du commerce et la délocalisation des emplois manufacturiers américains allaient bon train, les mouvements syndicaux de ces pays auraient pu être des alliés de choix pour le mouvement syndical américain dans sa lutte contre le nivellement par le bas et la promotion de normes plus exigeantes partout afin que le capital n’ait nulle part où aller. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé »
C’est un point essentiel. Le démantèlement des droits des travailleurs à l’étranger, appuyé par l’AFL et le CIO, a eu un effet boomerang pour les travailleurs américains lors de l’avènement de la mondialisation. Les grandes entreprises ont ensuite eu beau jeu de traiter les travailleurs américains de nantis assis sur des privilèges, soudain devenus trop chers par rapport aux chinois, indiens ou vietnamiens. Un syndicat ne peut pas être à la fois socialiste et impérialiste. Sur le long terme, c’est impossible. L’AFL-CIO a contribué à affaiblir les syndicats étrangers trop à gauche ou favorables à l’autonomisation de leurs pays, au grand bonheur de la CIA, mais le prix à payer a été une détérioration des conditions de travail des salariés américains. Dire que les femmes là-bas n’ont même pas droit à un congé maternité, sauf quelques « privilégiées » qui travaillent pour des entreprises de plus de 50 salariés, qui elles peuvent prendre jusqu’à 12 semaines… non indemnisées. La baisse du taux de syndicalisation des salariés aux Etats-Unis est tout sauf une surprise.