Quatre siècles avant la prise de la Bastille, la paysannerie
française s’est soulevée dans une grande révolte connue sous le nom de
Jacquerie. La classe dirigeante française a noyé la révolte dans le sang
et diabolisé tous ceux qui y ont pris part.
Source : Jacobin, Justine Firnhaber-Baker, Daniel Finn
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises
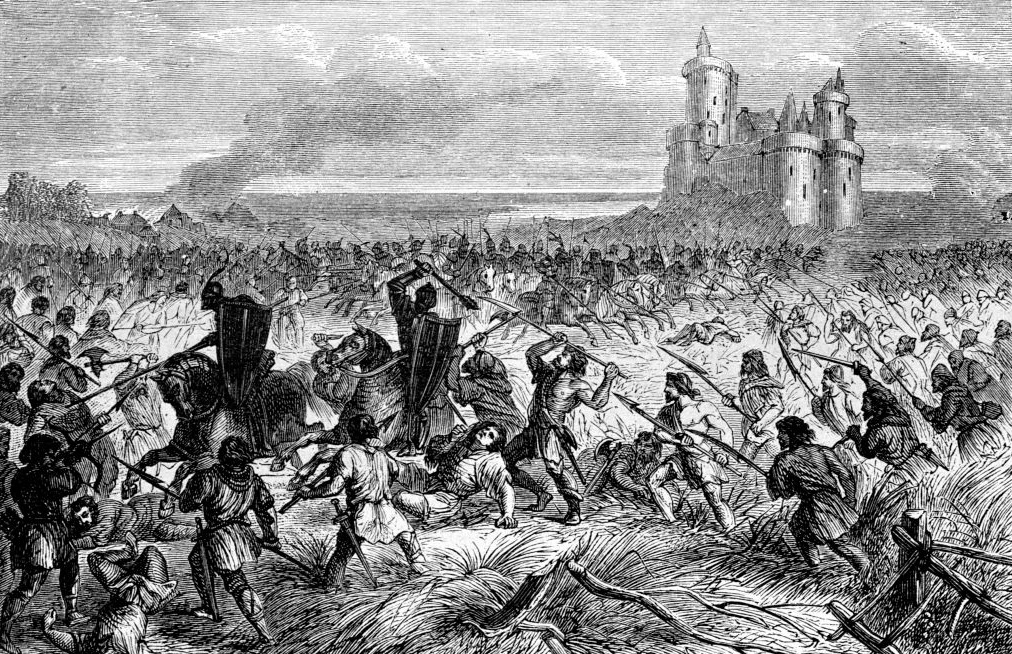
- Gravure de la Jacquerie de Beauvaisis, France, en mai-juin 1358. (Collection Roger Viollet / Getty Images)
Lorsque l’on évoque la tradition révolutionnaire française, on pense
très probablement à la prise de la Bastille et au renversement de la
monarchie. Mais ce n’était pas la première fois qu’il y avait un
soulèvement majeur contre l’ordre établi en France.
Dans la seconde moitié du XIVe siècle, une révolte populaire, la
Jacquerie, terrifie la classe dirigeante française. Ils ont noyé la
révolte dans le sang et ont entrepris de diaboliser les paysans qui y
avaient participé. Ce n’est que quatre siècles plus tard, à la suite
d’une révolution réussie, que les historiens ont commencé à jeter un
regard neuf sur la Jacquerie.
Justine Firnhaber-Baker est professeur d’histoire à l’université de
St Andrews et auteur de The Jacquerie of 1358 : A French Peasants’
Revolt, la première étude majeure sur la Jacquerie depuis le XIXe
siècle. Il s’agit d’une transcription éditée du podcast Long Reads de
Jacobin Radio. Vous pouvez écouter l’interview ici.
Daniel Finn : Quelle est la nature du système politique et de l’ordre social en France au XIVe siècle ?
Justine Firnhaber-Baker : Sur le plan politique, le
système était centralisé, en ce sens qu’il y avait un roi et un
gouvernement royal. Au milieu du XIVe siècle, au moment de la Jacquerie,
il existait une bureaucratie élaborée qui soutenait le gouvernement
royal central à tous les niveaux. Mais la structure du pouvoir était
également décentralisée, car les seigneuries locales et régionales
étaient très importantes.
Lorsque nous parlons des seigneurs médiévaux, nous parlons de
personnes qui avaient la juridiction et des droits fiscaux sur un
territoire particulier. Nous avions l’habitude de considérer le
gouvernement royal et les seigneurs comme des forces opposées, avec un
jeu à somme nulle entre eux : au fur et à mesure que le pouvoir royal
augmentait, le pouvoir des seigneurs devait diminuer.
Lorsque nous parlons de seigneurs médiévaux, nous parlons de
personnes qui avaient une juridiction et des droits fiscaux sur un
territoire particulier.
Mais de plus en plus, nous comprenons que ces deux niveaux de pouvoir
ont en fait travaillé ensemble. La couronne ne souhaitait pas se
débarrasser des seigneurs, et ces derniers voyaient de nombreux
avantages à coopérer avec le gouvernement royal. Je dois également
préciser, pour plus de clarté, que les seigneurs comprenaient le clergé :
les évêques, les monastères et les couvents, avec des propriétés où ils
exerçaient la seigneurie de la même manière que les seigneurs laïcs.
L’ordre social y est lié. Au Moyen-Âge, une façon très populaire de
concevoir l’ordre social était de le diviser en trois ordres. Le premier
ordre était le clergé : ceux qui priaient ; le deuxième ordre était les
nobles : ceux qui se battaient ; et le troisième ordre était constitué
de tous les autres : ceux qui travaillaient.
L’idée était que cette division reposait sur un contrat social : ceux
qui travaillaient remettaient les fruits de leur travail à ceux qui
priaient en échange d’une intercession auprès de Dieu et à ceux qui
combattaient en échange d’une protection. Ces deux premiers ordres de
clercs et de nobles occupaient souvent des fonctions seigneuriales en
plus de ce statut social.
Daniel Finn : Quel a été l’impact de la peste noire sur la société française au XIVe siècle ?
Justine Firnhaber-Baker : Il est difficile d’en
exagérer l’impact. La peste noire a atteint la France au cours de
l’hiver 1348, et les estimations de la mortalité varient entre 30 et 60
%. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec certitude que le taux de
mortalité se situait probablement dans la partie supérieure de cette
échelle, autour de 50 %. Vous pouvez imaginer l’impact de la perte de la
moitié de votre population en si peu de temps.
La première vague de peste a mis environ deux ans à suivre son cours.
La perte d’une telle proportion de la population en un tel laps de
temps a été incroyablement perturbante à court terme. Elle a interrompu
la première phase de la guerre de Cent Ans, qui durait depuis 1338.
Pendant quelques années après 1348, il y a eu une trêve pendant la
peste.
La peste noire a atteint la France au cours de l’hiver 1348, et les estimations de la mortalité varient de 30 à 60 %.
Les effets à plus long terme ont été encore plus profonds. L’un des
effets les plus importants a été la réduction de moitié de l’assiette
fiscale. La couronne et les seigneurs tiraient leur argent des
travailleurs, qui étaient désormais beaucoup moins nombreux. Pour
continuer à payer la guerre, qui était de plus en plus coûteuse au
milieu du XIVe siècle, il fallait presser les contribuables encore plus
fort.
Il y a également eu un impact social en raison de la façon dont les
élites sociales et politiques ont thésaurisé les ressources. Une façon
simpliste d’envisager la peste noire et l’économie est de dire que la
population a été réduite mais que les ressources sont restées les mêmes,
de sorte que tout le monde s’en est trouvé mieux. Dans la pratique,
cela n’a pas fonctionné de cette manière.
Nous avons constaté une amélioration absolue de la qualité de vie de
chacun, mais l’inégalité relative s’est probablement accrue. Bien qu’il
aurait dû y avoir plus de ressources disponibles, dans la pratique, ces
ressources n’ont pas été réparties de manière égale en raison de la
manière dont les lois sur la fiscalité et le travail ont été promulguées
et aussi parce que le marché foncier fonctionnait d’une manière qui
privilégiait la propriété des nobles par rapport à celle des roturiers.
Daniel Finn : Comment le conflit anglo-français, connu par
les historiens sous le nom de guerre de Cent Ans, a-t-il affecté le
peuple français ?
Justine Firnhaber-Baker : Vous avez raison de le
qualifier ainsi, car « guerre de cent ans » est un terme qui ne lui a
été appliqué que bien plus tard, à partir du XIXe siècle. À l’époque, on
ne savait évidemment pas qu’elle allait durer cent ans. Elle s’inscrit
dans le cadre d’un conflit permanent entre l’Angleterre et la France,
qui remonte au XIIIe siècle, voire avant.
Si l’on se concentre sur les deux décennies qui suivent 1338, date
conventionnelle du début de la guerre de Cent Ans, le conflit a été
beaucoup plus intense que tout ce que les Français avaient l’habitude de
vivre auparavant. Bien qu’il s’agisse d’une guerre entre l’Angleterre
et la France, elle se déroule principalement sur le territoire français.
L’un des principaux effets de la guerre sur le peuple français a été
l’augmentation de la fréquence des actes de violence. Au Moyen Âge, la
plupart des guerres ne prenaient pas la forme de batailles rangées entre
armées opposées. Elle prenait essentiellement la forme de raids en rase
campagne contre des non-combattants.
De nombreux roturiers français ont subi les effets de la guerre en
tant que victimes, mais ils ont également fait une nouvelle expérience
de la violence militaire en tant qu’auteurs. La guerre de Cent Ans a été
marquée par une militarisation de la société dans son ensemble, car les
roturiers étaient de plus en plus souvent appelés à combattre dans
l’armée royale.
Au XIVe siècle, l’infanterie est devenue plus importante dans les
armées médiévales, ce qui signifie qu’il y avait beaucoup plus de
roturiers dans l’armée qu’au cours des siècles précédents, et ce
changement a eu des effets logistiques. Les roturiers ont acquis la
capacité de se battre. Ils possédaient des armes, des armures et des
compétences en matière de commandement, ce qui a également eu un effet
social et psychologique. Ils se sont rendu compte que les nobles étaient
censés être les combattants, mais que désormais les ouvriers se
battaient aussi, et qu’ils étaient peut-être même meilleurs que les
nobles.
Au Moyen-Âge, la guerre prenait essentiellement la forme de raids en rase campagne contre des non-combattants.
À ce moment-là, la guerre se passe très mal pour l’armée française,
dont les structures de commandement sont dirigées par le roi et les
nobles. Deux ans avant la Jacquerie, en 1356, il y eut une grande
bataille à Poitiers, au cours de laquelle le roi de France fut fait
prisonnier par les forces anglaises et amené à Londres. Ceux-ci exigent
une énorme rançon et le royaume tombe dans une période de conflit
politique et de chaos parce qu’il a laissé le dauphin, son fils Charles
âgé de dix-huit ans, aux commandes.
Lorsque la Jacquerie éclate deux ans plus tard, le dauphin a perdu le
contrôle de Paris et d’une grande partie du nord de la France au profit
d’une rébellion bourgeoise menée par le chef des marchands parisiens.
Cette rébellion bourgeoise a commencé par s’associer au dauphin, mais
elle est rapidement entrée en conflit avec lui en raison de son désir de
réformer les structures de gouvernement du royaume. Ils se heurtent
également aux partisans nobles du dauphin, qui s’opposent à leurs
efforts pour contrôler l’armée et taxer les nobles au même taux (au
moins) que les roturiers.
Au cours de l’hiver 1358, la rébellion bourgeoise et le dauphin sont
engagés dans un conflit très grave et très violent. Le chef de la
rébellion fait assassiner deux maréchaux nobles de l’armée devant le
dauphin dans sa chambre à coucher.
Le dauphin se retire de Paris et commence à élaborer des plans avec
ses nobles partisans pour reprendre la ville par la force. Ils
établissent des garnisons dans deux grands châteaux situés sur deux des
trois principaux cours d’eau qui approvisionnent Paris en nourriture.
C’est à ce moment-là, alors que le dauphin et ses partisans nobles
observent Paris qui ne sait pas trop ce qu’elle va faire, que la
Jacquerie débute.
Daniel Finn : Quand la Jacquerie a-t-elle commencé ? Était-ce un événement spontané ou quelque chose de planifié à l’avance ?
Justine Firnhaber-Baker : Il y a eu un peu des deux.
Le premier incident, qui a eu lieu le 28 mai 1358, n’était certainement
pas spontané. Les sources s’accordent à dire que les rebelles se sont
d’abord rassemblés à partir de plusieurs villages, puis se sont rendus
dans une ville située sur l’Oise (la seule rivière que le dauphin
n’avait pas bloquée) où ils ont attaqué neuf nobles.
Cette cible a été soigneusement choisie. Les nobles étaient dirigés
par un chevalier du nom de Raoul de Clermont-Nesle, qui était apparenté à
l’un des nobles maréchaux que les bourgeois rebelles avaient tué devant
le dauphin quelques mois plus tôt. La motivation devient assez claire
lorsque l’on connaît la géographie locale.
J’y suis allé et je me suis promené dans les environs en me disant : «
Pourquoi ici ? » À première vue, la ville semble avoir été choisie au
hasard. Mais il s’agissait d’empêcher Raoul de Clermont-Nesle, les huit
nobles qui l’accompagnaient, et probablement aussi un certain nombre de
troupes, de traverser la rivière à cet endroit et d’établir une garnison
dans un château situé un peu plus haut sur la rivière. Cela leur aurait
permis de bloquer l’Oise de la même manière que le dauphin et ses
partisans nobles bloquaient les deux autres rivières.
Les habitants des campagnes ont une très bonne idée de ce qui se passe à Paris, et beaucoup d’entre eux l’approuvent.
Ce premier incident semble avoir été planifié, et il avait clairement
des liens avec la rébellion bourgeoise à Paris, bien que je ne pense
pas que le premier incident ait été planifié par ceux de Paris, car il
semble les avoir pris par surprise. Je pense que les roturiers et les
paysans ont agi de leur propre chef, car nous savons que les habitants
des campagnes étaient parfaitement au courant de qui se passait à Paris
et que nombre d’entre eux l’approuvaient. Ce qu’ils comprenaient de ce
qui se passait à Paris, c’est qu’on y tuait des nobles, et notamment ces
maréchaux qui avaient été trucidés devant le dauphin.
Ce premier incident semble avoir été soigneusement ciblé en tant
qu’attaque militaire et stratégique. Ce qui en a découlé, d’une certaine
manière organique, était lié à ce premier incident mais distinct. La
révolte qui a suivi a commencé lors d’une deuxième assemblée tenue à la
suite de la première attaque. C’est à ce moment-là que les paysans ont
choisi un chef, un capitaine appelé Guillaume Calle.
Il semble que Guillaume Calle et les hommes qui l’entourent
(peut-être aussi certaines femmes) avaient un plan. Mais cela ne
signifie pas nécessairement que ce plan était dans l’esprit de tous ceux
qui ont rejoint la Jacquerie par la suite. Il est important de se
rappeler qu’il ne s’agit pas d’un mouvement unique. Il était composé de
milliers (peut-être de dizaines de milliers) de personnes qui avaient
des idées différentes sur ce qu’elles faisaient. Ils n’étaient pas tous
en contact les uns avec les autres, et leurs idées et leurs objectifs
ont changé au cours des six à huit semaines qu’a duré la révolte.
Daniel Finn : Alors que la révolte s’étendait, devenant une
convergence de nombreuses révoltes différentes, comme vous le soulignez,
comment les rebelles se sont-ils organisés, et quelles étaient
certaines des principales revendications qu’ils mettaient en avant ?
Justine Firnhaber-Baker : Guillaume Calle, qu’ils
ont élu après le premier incident, était connu comme le capitaine
général de la campagne (le capitaine de la région autour de la ville de
Beauvais, qui était le cœur de la Jacquerie). Calle semble avoir eu
quelques lieutenants de haut niveau qui chevauchaient avec lui, lui
donnaient des conseils et étaient disponibles pour porter des messages
aux autres régions impliquées dans la Jacquerie.
Au-dessous de ce niveau supérieur, il y avait une couche de
capitaines de village. Certains éléments indiquent que chaque village
avait son capitaine et que le capitaine avait également un subordonné,
de sorte qu’il y avait probablement un capitaine et un lieutenant dans
chaque village. Il y avait donc une sorte de hiérarchie à deux niveaux,
mais pas une hiérarchie très stricte. Nous disposons de nombreux
éléments indiquant que les gens pouvaient simplement aller parler à
Calle et qu’ils ne faisaient pas toujours ce qu’il leur disait de faire.
Il s’agissait d’un mouvement populaire, car Calle a été choisi par la
base plutôt que d’être imposé au mouvement. Les capitaines de village
étaient pour la plupart choisis par leur propre village. C’était l’un
des points forts de la révolte, mais cela a également donné lieu à une
lutte pour l’autorité.
Il existe des preuves que chaque village avait son capitaine et que
le capitaine avait également un subordonné, de sorte qu’il y avait
probablement un capitaine et un lieutenant dans chaque village.
Les dirigeants disaient : « Je suis le capitaine, nous devons
poursuivre mes objectifs », mais les soldats répondaient : « Nous vous
avons nommé capitaine pour que vous fassiez ce que nous voulons faire. »
Il y avait un certain degré de tiraillements à ce moment-là.
En ce qui concerne certaines révoltes de l’Europe médiévale, nous
savons beaucoup de choses sur les revendications spécifiques parce que
les rebelles en ont dressé une liste. Mais nous n’avons rien de tel pour
la Jacquerie. Nous savons qu’à un moment donné, des documents écrits
ont été échangés, des lettres ont été envoyées aux villes que les
Jacques voulaient voir participer à la révolte, etc. Mais aucun de ces
documents n’a survécu, que ce soit par accident ou à dessein, et nous
devons donc discerner leurs motivations de différentes manières.
L’une d’entre elles consiste à examiner ce que les chroniqueurs de
l’époque avaient à dire. Selon les chroniques, lorsque les Jacques ont
formulé un motif en paroles, il s’agissait de détruire les nobles, qui
ne défendaient pas le royaume et les paysans comme ils étaient censés le
faire, mais s’emparaient au contraire de tous leurs biens.
Il s’agit d’une critique basée sur le contrat social des trois
ordres. Les paysans étaient censés remettre leurs produits parce que les
nobles les protégeaient, mais dans ce cas, les nobles ne les
protégeaient pas. De plus, ils étaient en train de perdre la guerre de
Cent Ans de manière désastreuse et ne méritaient donc pas leur statut de
nobles et les biens de luxe qui l’accompagnaient.
Je dois dire ici que le nom même de la révolte vient du nom donné aux
soldats de souche : « Jacques Bonhomme » était à l’origine un surnom
dérisoire, mais les soldats roturiers l’avaient adopté avec fierté.
Certains rebelles s’appelaient eux-mêmes Jacques Bonhomme avec le
sentiment qu’ils pouvaient désormais diriger le royaume puisqu’ils
étaient plus doués que les nobles pour la guerre. Il se peut également
qu’il y ait eu un chevauchement entre les hommes de l’armée qui
s’appelaient Jacques Bonhomme et les hommes qui occupaient des postes de
direction pendant la révolte.
C’est ce que disent les chroniques, et c’est très logique, mais il
faut aussi être quelque peu critique, car ce motif est celui que l’on
attribue à toutes les révoltes paysannes du Moyen-Âge. Il a rendu les
révoltes intelligibles pour les élites en termes de théorie sociale des
trois ordres qu’elles ont embrassé. Il n’est pas surprenant qu’elles
aient adhéré à cette théorie, car elle leur était très utile. Elle leur
permettait d’expliquer pourquoi ils pouvaient s’approprier les fruits du
travail des paysans.
Dans la mesure où cette explication permettait de critiquer la
noblesse, il ne s’agissait pas d’une critique de l’ordre social
inégalitaire lui-même. Il s’agissait simplement du fait que les nobles
ne remplissaient pas leur part du marché. S’ils recommençaient à la
remplir, ils pourraient alors extraire les surplus de la paysannerie.
L’autre façon d’examiner ce que les Jacques recherchaient et pourquoi
est d’extrapoler les motifs de leurs actions. Les chroniqueurs se
concentrent sur le fait que les Jacques ont tué des nobles. Mais si nous
regardons ce qu’ils ont réellement fait, à l’exception du premier
incident où ils ont tué neuf nobles, ils n’ont pas tué des gens très
souvent. Ces neuf nobles tués ce jour-là représentent un tiers des
nobles identifiables que nous savons avoir été tués pendant la révolte.
Les Jacques concentrent leur violence sur la destruction des forteresses et des maisons nobles.
Les Jacques ont concentré leur violence sur la destruction des
forteresses et des maisons nobles. Il y a trois points à considérer ici.
Tout d’abord, nous pouvons y voir une forme de soutien à Paris : une
tactique de diversion, éloignant les nobles de l’armée que le dauphin
rassemblait pour attaquer Paris.
Il voulait rassembler l’armée au sud de Paris, mais la Jacquerie
éclata au nord de la ville, ce qui ramena une partie des forces alliées
au dauphin vers le nord et retarda l’attaque sur Paris. Il y eut aussi
des moments où les Jacques se joignirent aux milices parisiennes qui
tentaient de reprendre une des forteresses fluviales que le dauphin
occupait.
Cependant, une grande partie de la violence des Jacques semble avoir
été beaucoup plus sociale que militaire ou politique. C’est le deuxième
élément à prendre en considération. Ils se sont concentrés sur les
forteresses et les maisons nobles en raison de la manière dont ces
bâtiments faisaient la publicité du statut social des nobles et de leur
richesse excessive. Il est important de noter que certaines des
structures que les nobles appelaient châteaux au milieu du XIVe siècle
avaient des capacités militaires dérisoires – il s’agissait en fait de
bâtiments destinés à l’étalage de la richesse et du statut.
Il est également important de noter qu’ils s’attaquaient à des nobles
et non à des seigneurs. La Jacquerie n’était pas une révolte
anti-seigneuriale. Ils n’ont pas attaqué leurs propres seigneurs, ce qui
est très intéressant. Nous pouvons dire que la seigneurie en tant que
telle, par opposition à la noblesse, n’était pas la cible parce
qu’aucune des seigneuries cléricales n’a été attaquée. Les évêques et
les monastères possédaient de vastes seigneuries, mais ils n’étaient pas
du tout visés.
Le troisième point est qu’il y a une manière intéressante dont
l’animosité anti-noble de la Jacquerie se superpose à la motivation
parisienne, parce que Paris était le grand ennemi du dauphin et que les
partisans du dauphin étaient les nobles. Il est possible de considérer
la révolte non seulement comme une révolte anti-noble, mais aussi comme
une révolte anti-royale, ou du moins comme une révolte contre la
dynastie des Valois, en raison de l’étroite imbrication des nobles avec
le dauphin et l’État royal.
Daniel Finn : Les révoltes ont-elles été soutenues dans les villes de ce qui était alors la France urbaine ?
Justine Firnhaber-Baker : Oui, tout à fait. J’ai
beaucoup parlé de Paris, mais il y avait un certain nombre d’autres
villes de province dans le nord et l’est de la France, comme Amiens,
Beauvais, Caen et Senlis. À cette époque, il existe une nette
distinction entre les villes et les campagnes. Les villes se distinguent
notamment par la possession de murailles et, parce que leur statut
politique est quelque peu différent, elles sont davantage impliquées
dans la politique du royaume. Elles sont appelées à se rendre aux
assemblées des trois domaines, ce qui n’est pas le cas des habitants des
campagnes.
En même temps, il y avait beaucoup d’interpénétration entre la ville
et la campagne. Les citadins possédaient des propriétés à la campagne,
et les habitants de la campagne venaient constamment dans les villes
pour travailler, faire du commerce, se divertir et s’occuper d’affaires
administratives.
Lorsque la révolte éclate le 28 mai et se prolonge au moins jusqu’à
la mi-juin, les villes sont d’abord assez solidaires. Elles ouvrent
leurs portes et laissent entrer les Jacques, en mettant à leur
disposition des tables avec du vin et de la nourriture pour les
rafraîchir en chemin. Les citoyens et même les milices de la ville se
joignent aux attaques des châteaux et des manoirs voisins. Cela fait
partie de leur alliance préexistante avec la rébellion bourgeoise à
Paris.
Lorsque la révolte éclate le 28 mai et se prolonge au moins jusqu’à la mi-juin, les villes sont d’abord assez solidaires.
Une fois de plus, nous pouvons constater l’interpénétration de la
rébellion parisienne, qui était liée mais distincte, avec la Jacquerie.
Mais à l’exception de Senlis, toutes ces villes ont abandonné la
Jacquerie lorsque les choses ont commencé à se gâter vers la mi-juin.
C’était un problème fatal pour les Jacques, car les murs de la ville
étaient la seule architecture défensive dont ils disposaient. Ils
devaient pouvoir se retrancher derrière ces murailles.
L’autre forme d’architecture défensive aurait été les châteaux, mais
les Jacques avaient détruit les châteaux plutôt que de les occuper. De
toute façon, les rebelles étaient composés de groupes très importants,
et peu de châteaux auraient pu accueillir autant de monde. Lorsque les
villes ont fermé leurs portes et ont déclaré « Nous ne voulons plus
faire partie de tout cela », les Jacques ont été laissés en rase
campagne face aux armées nobles, et ils ont été massacrés.
Daniel Finn : Pourriez-vous nous expliquer plus en détail le
déroulement des événements militaires de la Jacquerie et la façon dont
elle a finalement été vaincue ?
Justine Firnhaber-Baker : Du 28 mai au 10 juin, les
Jacques sont effectivement maîtres de la campagne. Ils attaquent plus
d’une centaine de châteaux. Dès le 5 juin, la milice parisienne se met
en marche pour rejoindre la Jacquerie. Encore une fois, je ne pense pas
que les Parisiens soient à l’origine de la révolte, mais ils étaient
prêts à joindre leurs forces à celles des Jacques.
Le 9 juin, les forces de la Jacquerie étaient présentes dans toute la
campagne au nord de Paris, s’étendant probablement vers une région du
pays appelée Picardie, presque jusqu’à la Belgique. À l’est de la
campagne, une armée combinée de Jacques et de Parisiens se dirige vers
un château à Meaux, une ville qui contrôle la rivière Marne qui se jette
dans Paris. Leur intention était d’attaquer ce château et de le placer
sous le contrôle de Paris.
Le 10 juin, l’armée combinée attaque le château de Meaux, qui est
détruit. Ils sont massacrés comme des porcs dans les rues de Meaux en
raison de l’architecture défensive du château. Ils espéraient le
submerger par le nombre, mais la conception du château permettait à un
très petit nombre d’hommes de le défendre.
Probablement le même jour, au nord de Paris, une grande armée de la
Jacquerie dirigée par Guillaume Calle a affronté une armée noble dirigée
par Charles, qui était le roi du pays espagnol de Navarre. Charles
avait également des prétentions au trône de France et était un grand
seigneur normand, ce qui explique sa présence. En outre, cette noble
armée comprenait de nombreux Anglais.
On peut voir le début d’une contre-insurrection à partir du 10 juin, que nous appelons la Contre-Jacquerie.
L’armée dirigée par Charles a complètement submergé les Jacques, et
ce de manière très déshonorante. Charles avait envoyé un messager à
Guillaume Calle et lui avait dit : « Je voudrais faire un marché. »
C’était tout à fait normal à la veille d’une bataille. Mais lorsque
Calle est allé à la rencontre du roi de Navarre, il a été saisi et
décapité, probablement avec certains de ses capitaines. Les nobles
attaquent alors l’armée jacquaire sans chef et la détruisent.
Tout cela s’est passé le 10 juin, date souvent citée comme étant
celle de la fin de la Jacquerie, bien qu’elle se soit poursuivie pendant
encore six semaines, jusqu’en juillet et même au-delà dans certains
endroits. Cependant, nous pouvons voir le début d’une
contre-insurrection à partir du 10 juin, que nous appelons la
Contre-Jacquerie. De nombreux nobles qui s’étaient cachés reprennent
courage et commencent à se venger.
À l’est du pays, le dauphin mène une campagne de nobles qui se
vengent plus ou moins à leur guise. À l’ouest, c’est Charles, le roi de
Navarre. À l’origine, les Jacques pensaient que Charles pourrait les
aider, car il était allié aux Parisiens, mais ce ne fut pas le cas. Les
Jacques se sont défendus, il ne s’agissait donc pas d’un simple
retournement de situation. Mais après le 10 juin, une révolte sociale
des non-nobles contre la noblesse est devenue une guerre sociale entre
nobles et non-nobles.
On peut affirmer que la Jacquerie est définitivement enterrée à la
fin du mois de juillet. Un contre-coup d’État a lieu à Paris le 31
juillet et le chef de la rébellion bourgeoise est tué. Le dauphin
revient à Paris et fait exécuter de façon spectaculaire les derniers
rebelles éminents, mais il tire ensuite un trait sur tout cela et
commence à accorder des grâces à quiconque s’est trouvé impliqué dans la
rébellion bourgeoise, la Jacquerie, ou les louables efforts de
répression qui s’ensuivent.
Je dirais que ce moment marque la fin de la Jacquerie. Il y a encore
des échos épars dans différentes parties du royaume, mais ils ne sont
pas vraiment liés au mouvement original ; ce sont des imitations. Il y a
également eu des conflits qui, plus tard, ont été considérés comme
faisant partie de la Jacquerie en raison du moment où ils ont eu lieu
plutôt que parce qu’ils faisaient réellement partie de la révolte.
Daniel Finn : La révolte a-t-elle laissé un héritage tangible à la France après sa défaite ?
Justine Firnhaber-Baker : Pendant quelques
décennies, oui. Nous pouvons retracer l’héritage des révoltes à travers
les procès, principalement entre ceux qui ont subi des dommages lors de
la révolte ou de sa noble répression et ceux qu’ils tenaient pour
responsables de ces dommages. Les documents juridiques, en particulier
ceux du Moyen-Âge, ont ceci de merveilleux qu’ils racontent souvent de
belles histoires sur tout ce qui a conduit au procès et sur toutes les
rancœurs qui en ont affecté le cours.
Il est clair que de nombreuses personnes n’ont pas accepté l’idée de
tirer un trait sur ces événements : elles étaient toujours en colère.
Des non-nobles ont été tués des décennies après la révolte en raison de
leur association à celle-ci, et des procès ont été intentés pendant
trente ans. La révolte a également laissé des traces matérielles. Nous
savons, grâce à des inventaires ultérieurs des propriétés nobles, que
même au tournant du quinzième siècle, des bâtiments étaient encore
répertoriés comme étant en ruine à cause du « temps des commotions »,
c’est-à-dire ce qu’on appelait la Jacquerie.
Des non-nobles ont été tués des décennies après la révolte en raison
de leur association à celle-ci, et des procès ont été intentés pendant
trente ans.
Pendant un certain temps, le mot « jacquerie » est devenu une
insulte. Il s’agissait d’une monnaie du milieu du XIVe siècle, et la
révolte était alors désignée sous le nom de Jacquerie. Mais quelques
décennies plus tard, c’était le genre de chose qu’une personne pouvait
dire après s’être battue dans une taverne : « Vous n’êtes qu’une ordure;
retournez à votre jacquerie. »
À la fin du XIVe siècle, le souvenir s’est estompé. Dans le nord de
la France, il n’y a pas eu de rébellion paysanne majeure pendant très
longtemps. Les villes, en particulier Paris, se sont soulevées à maintes
reprises, et la plupart des rébellions urbaines de l’Europe médiévale
auraient eu une contrepartie rurale, mais cela ne s’est pas produit dans
le nord de la France.
Je me demande si cela n’a pas été, à sa manière, un héritage de la
révolte du quatorzième siècle. Les habitants des villes auraient pu se
dire : « La dernière fois que la campagne a été impliquée, nous avons
perdu le contrôle, nous allons donc éviter cela à l’avenir. » Mais
hormis le fait qu’elle figure dans l’une des chroniques les plus
populaires du Moyen-Âge, la révolte n’a pas laissé beaucoup de souvenirs
jusqu’à la fin du dix-huitième siècle.
Daniel Finn : Comment la Jacquerie a-t-elle été mémorisée et interprétée par les historiens au cours des siècles suivants ?
Justine Firnhaber-Baker : Comme je l’ai dit, elle a
été oubliée pendant longtemps. Le mot « jacquerie » réapparaît pour la
première fois en anglais et en français à la fin du XVIIIe siècle, à
l’époque de la Révolution française. C’est à cette époque que les
historiens ont commencé à s’intéresser aux gens du peuple comme ils ne
l’avaient jamais fait auparavant. C’était en grande partie un reflet de
ce qui se passait à leur propre époque, puisqu’ils ont commencé à
chercher les germes de 1789 dans les rébellions médiévales bien
antérieures.
Le premier livre sur la Jacquerie (et en fait le dernier jusqu’à la
publication de mon propre livre en 2021) a été publié en 1859. C’est en
partie un héritage des mouvements sociaux et politiques du dix-neuvième
siècle. C’est aussi lié à la professionnalisation de l’histoire et à la
découverte de nouvelles sources, notamment juridiques, qui ont permis à
l’auteur Siméon Luce d’écrire une histoire beaucoup plus large de la
révolte.
Le livre de Luce se fonde sur ces documents juridiques, ainsi que sur
les récits très stéréotypés que l’on trouve dans les chroniques. Il
affirmait que la Jacquerie était organisée, politique et liée à la
révolte parisienne. Mais très vite, une réaction s’est élevée contre
cette interprétation, arguant qu’il ne pouvait en être ainsi, car les
paysans étaient des rustres, incultes et ivrognes, incapables de
planifier, et encore moins d’organiser une action politique coordonnée
avec une grande ville comme Paris.
Cette interprétation rivale présente la Jacquerie comme une éruption
spontanée de haine paysanne totalement irrationnelle. Il n’y a pas eu de
planification, elle a simplement explosé. Ces deux écoles de pensée ont
continué à encadrer la discussion sur la révolte. Tous ceux qui
écrivent sur le sujet prennent parti pour l’un ou l’autre camp.
Un livre récent sur la guerre de Cent Ans, par exemple, affirme que
la Jacquerie était le résultat de la brutalisation des paysans par la
guerre : dans leur brouillard, ils ne pouvaient plus distinguer les amis
des ennemis ; le seul ennemi était un noble. Mon livre penche nettement
plus en faveur de l’idée que la Jacquerie était organisée, politique et
liée à la révolte parisienne. Mais l’une des choses que je voulais
souligner, c’est qu’il s’agissait d’un mouvement hétérogène.
Je ne pense pas que les personnes impliquées dans la Jacquerie aient
été stupides ou incapables de planifier; rien ne prouve non plus
qu’elles étaient ivrognes. Mais la révolte n’était pas uniquement liée
aux objectifs militaires et politiques spécifiques de Paris. Elle était
beaucoup plus organique et beaucoup plus critique à l’égard de la
noblesse d’un point de vue économique, social et même esthétique qu’elle
ne l’était à l’égard du conflit entre le parti noble et le parti
bourgeois à Paris.
Justine Firnhaber-Baker est professeure d’histoire à l’université de
St Andrews. Elle est l’autrice de La Jacquerie de 1358 : A French
Peasants’ Revolt (2021) et de Violence and the State in Languedoc,
1250-1400 (2014).
Daniel Finn est rédacteur en chef de Jacobin. Il est l’auteur de One Man’s Terrorist : A Political History of the IRA.
Source : Jacobin, Justine Firnhaber-Baker, Daniel Finn, 13-09-2024
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises




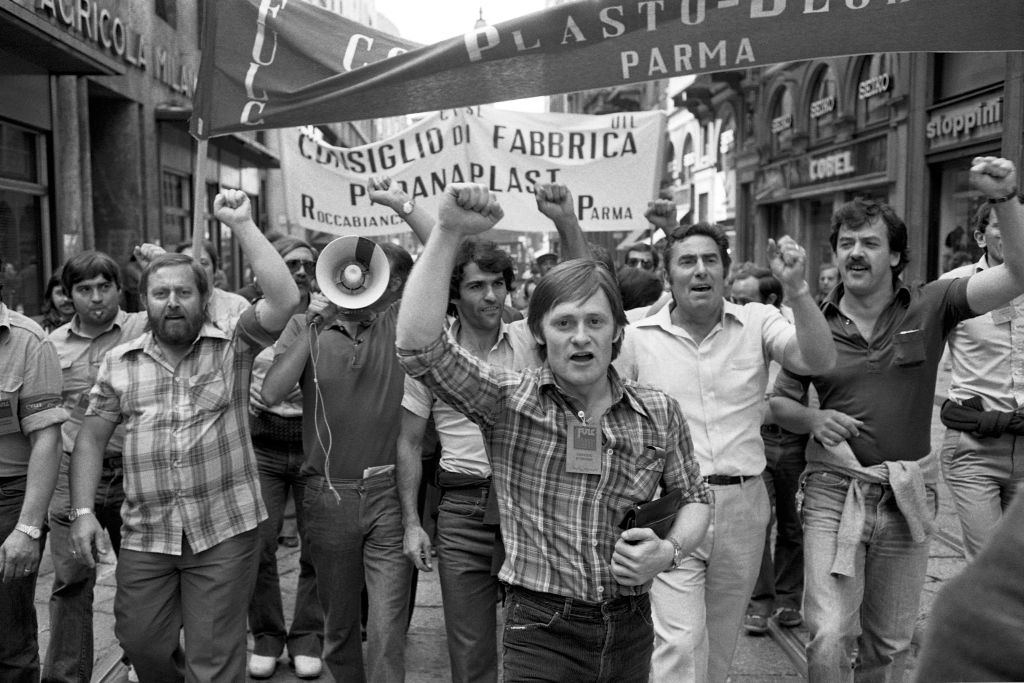


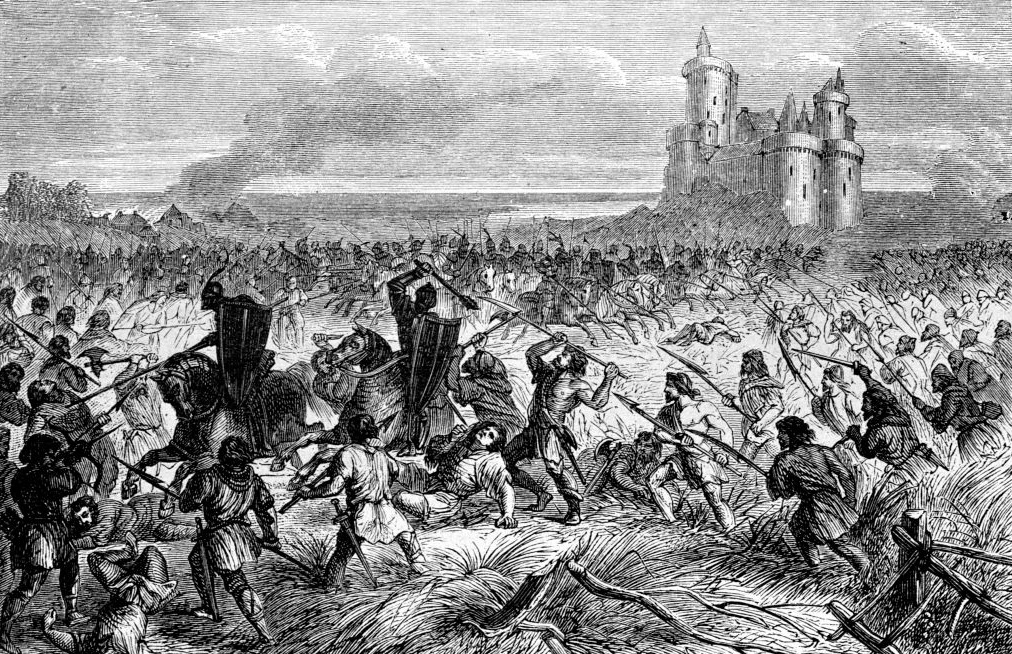

Plus intéressant serait de rappeler les opérations « d’influence » des services américains en France pour contrer le syndicalisme des marxistes , de la CGT qui risquait d’entraver le plan Marshall. La création de Force Ouvrière par exemple par le célèbre trotskiste Kristol (un des inspirateurs du neo conservatisme/libéralisme) d’abord opposé au communisme quoi qu’il en coûte ( Militant trotskiste aux usa il convertit son action en Europe au service des libéraux us) L’ « écueil » ( comme Brezinski nommait la France ) serait peuplé de « gallo communistes » s’inquiètent les américains (et Cohn Bendit ) dont des syndicalistes. L’histoire française de cette ingérence par les services us mériterait un billet svp
Mme Annie Lacroix-Riz
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Annie_Lacroix-Riz ,
a abondament ecrit sur le sujet et bien plus…
Bonne lecture.
« Alors que la libéralisation du commerce et la délocalisation des emplois manufacturiers américains allaient bon train, les mouvements syndicaux de ces pays auraient pu être des alliés de choix pour le mouvement syndical américain dans sa lutte contre le nivellement par le bas et la promotion de normes plus exigeantes partout afin que le capital n’ait nulle part où aller. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé »
C’est un point essentiel. Le démantèlement des droits des travailleurs à l’étranger, appuyé par l’AFL et le CIO, a eu un effet boomerang pour les travailleurs américains lors de l’avènement de la mondialisation. Les grandes entreprises ont ensuite eu beau jeu de traiter les travailleurs américains de nantis assis sur des privilèges, soudain devenus trop chers par rapport aux chinois, indiens ou vietnamiens. Un syndicat ne peut pas être à la fois socialiste et impérialiste. Sur le long terme, c’est impossible. L’AFL-CIO a contribué à affaiblir les syndicats étrangers trop à gauche ou favorables à l’autonomisation de leurs pays, au grand bonheur de la CIA, mais le prix à payer a été une détérioration des conditions de travail des salariés américains. Dire que les femmes là-bas n’ont même pas droit à un congé maternité, sauf quelques « privilégiées » qui travaillent pour des entreprises de plus de 50 salariés, qui elles peuvent prendre jusqu’à 12 semaines… non indemnisées. La baisse du taux de syndicalisation des salariés aux Etats-Unis est tout sauf une surprise.