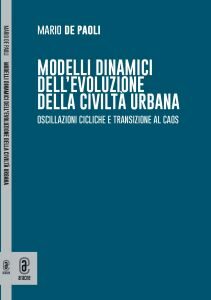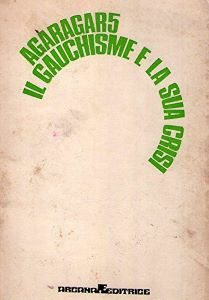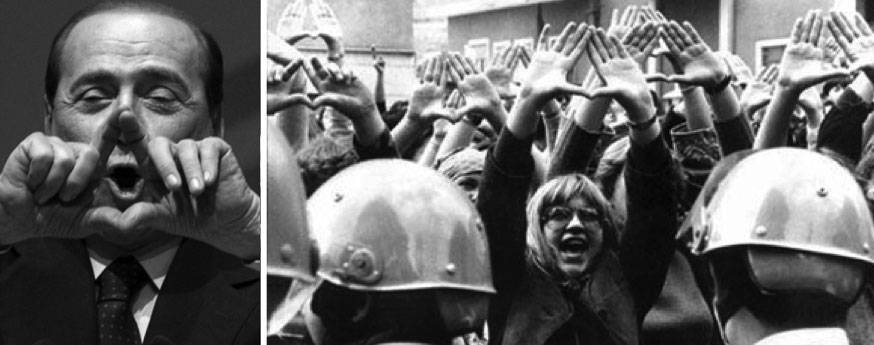par Marc Tibaldi
La revue Agaragar, dirigée par le philosophe Mario Perniola a eu 5 numéros de 1970 à 1972, 3 publiés par Silva Editore et 2 par Arcana Editrice (en 2020 ils ont été réédités par PGreco). Agaragar était un e revue né de la rencontre avec le mouvement situationniste, en particulier avec Guy Debord, avec lequel Perniola avait établi une relation d'amitié et de polémique. Dans les années 1960, Perniola était entré en contact en France avec le mouvement étudiant et avec les derniers rejetons du surréalisme, devenant l'une des premiers à porter en Italie les thèses du mouvement situationniste, grâce à Agaragar. La pensée que Perniola a développé au cours de ces années restera dans ses réflexions avec l'attention de mettre en évidence les contradictions et la complexité de la société du spectacle. Cofondateur d'Agagar, avec Perniola, Mario De Paoli qui, après la fin de la revue, a poursuivi ses recherches en développant – dans une série de publications – une théorie originale de la complexité qui réunit l'analyse de l'évolution des processus sociaux et l'analyse de la dynamique des processus psychiques. Ses recherches méritent d'être connues, c'est pourquoi nous sommes allés l'interviewer. De Paoli, né à Dolo, Venise, en 1940, vit à Padoue, une ville où il est d'abord diplômé en chimie, puis en physique et où il a enseigné au lycée scientifique Eugenio Curiel.
Il nous dit d'abord comment il a rencontré Mario Perniola et comment a été la naissance d'Agaragar ?
Nous nous sommes rencontrés pendant notre service militaire à
Padoue, à la fin des années 1960. Nous venions de terminer l'université, moi en études scientifiques, malgré les différentes
formations, il y avait une sensibilité culturelle en commun et après
avoir lu mon étude (qui sera publiée dans le troisième numéro du
magazine avec le titre: « Market Economics and Rational Language: Money
and Logos »), qui m'a proposé de participer à l'élaboration d'Agaragar. Au
cours de ces années, il a travaillé sur les études qui vont ensuite
fusionner dans l'Aliénation Artistique, qui, je pense, est
toujours l'un de ses meilleurs livres. La première année, il n'y avait
que nous deux dans la rédaction, il s'intéressait également aux
relations avec l'éditeur Silva. Avec Perniola, j'avais des points
communs et quelques différences. Il part de la question de l'aliénation
artistique, dans laquelle il considère la séparation d'une réalité
dénuée de sens dans l'économie politique et d'un sens sans réalité dans
l'art. Cette séparation a été accentuée à la Renaissance avec la
séparation de l'art et de l'artisanat. Séparation significative marquant le
début de la fracture entre production matérielle et production
immatérielle. Séparation décisive pour comprendre que le capitalisme a
agi non seulement au niveau de la production matérielle, mais aussi au
niveau linguistique/immatériel. Il était important d'examiner le
développement du capitalisme au niveau du contrôle de la production
matérielle mais aussi dans la production immatérielle: dans la
littérature, dans les processus psychiques, en science. Il ne faut pas
oublier que Perniola sur Agaragar fait également une critique du
situationnisme. Les situationnistes ne considéraient qu'un seul aspect
de la séparation entre la réalité et le sens, ils n'ont pas ramené le
sens des processus linguistiques à la réalité, ces deux aspects devaient être recomposés.
Perniola, dans Terrorisme comme l'un des beaux-arts
(Mimesis, 2014), l'un de ses derniers livres, consacre un chapitre à
l'aventure d'Agaragar, et parle également de votre rencontre avec Debord.
Avez-vous lu les situationnistes avant de connaître Perniola ?
Non. Je connaissais la pensée de l'école de Francfort. Dans mes
réflexions sur le lien entre le capitalisme commercial et le langage
rationnel, j’avais à l’esprit Adorno et Horkheimer qui, dans Dialettica
of the Enlightenment, décrivent Ulysse comme le premier «Enlightenment»
qui utilise le langage pour avoir un avantage.
Nous sommes allés à Bruxelles pour rencontrer Guy Debord et Raoul
Vaneigem. Debord ne nous a pas très bien accueilli. Il nous a renvoyé à jouer au foot. Graziella, la très gentille épouse de Perniola, se moquait discrètement de Debord, qui lui semblait arrogant et antipathique. La relation était beaucoup mieux avec Vaneigem. Je me souviens en
particulier d'une discussion dans une brasserie où j'ai souligné que «
l'imagination au pouvoir » était celle du capitalisme qui contrôlait la
production d'informations.
Dans les années où vous avez conçu le magazine, il y avait au
moins deux autres personnes en Italie qui suivaient de près le
situationnisme, Giorgio Agamben et Gianni-Emilio Simonetti. As-tu eu
des relations avec eux ?
Simonetti je ne l'ai jamais connu. Agamben était un ami de Perniola, je
me souviens que nous allions lui rendre visite sur un de ses domaines,
près de Rome. Agamben a insisté pour que je monte un cheval
qu'il disait docile et qui partit dans un galop infernal.
Pendant mon séjour dans la maison romaine des Perniola, à l'occasion
de mon écriture de L'éducation comme un processus productif, j'ai
accroché une affiche représentant la louve du Capitole avec l'un des
jumeaux crachant du lait, et en-dessous j'ai écrit les mots « enfants du
monde, unissez-vous ». Un matin, Graziella, la très gentille épouse
de Mario, m'a fait croire que Perniola avait rêvé qu'il était Marx et
moi Engels. Je raconte ces anecdotes car elles mettent en lumière les détournements ludiques du groupe.
La première année, il n'y avait que nous deux dans la rédaction,
Perniola s'occupait également des relations avec l'éditeur Silva. La
collaboration entre nous ne s'est pas poursuivie au-delà du début des
années 70, mais malgré nos chemins culturels, les intérêts
philosophiques chez lui, scientifiques chez moi, cela n'a pas affecté notre amitié
et, au fil des ans, nous avons continué à nous entendre, en échangeant
certains des livres que nous avions publiés.
Comment Agaragar a-t-il été reçu dans le débat idéologique de ces années-là? Cela a-t-il suscité des discussions?
Le débat culturel, les discussions et les critiques ont été très intenses dans les années 70 parce que, précisément à cette époque, il y a
eu un changement de paradigme dans le mode de production du capital (la
transition du fordisme au toyotisme a commencé en 1976). Mais, alors que le
capital financier recombinait une nouvelle synthèse de la production
matérielle et de la production immatérielle, les différents mouvements
de gauche sont restés divisés entre eux, oscillant entre les extrêmes de l'ouvriérisme et du situationnisme. Agaragar a proposé une «synthèse
sociale» alternative à celle du capital. Le magazine a été
accueilli avec un certain enthousiasme, mais a également été mal
compris. Pour donner un exemple : Giuseppe Sertoli, rédacteur en chef de Nuova
Corrente (qui en ces années était un magazine important de littérature
et de philosophie, note de l'éditeur) alors qu'il s'est déclaré en parfait accord avec les
écrits de Perniola, a sévèrement critiqué mes écrits du premier
numéro de la revue. Perniola et moi lui avons répondu par une lettre de
quatre pages indiquant l'importance de notre recherche d'une nouvelle
synthèse sociale. Nous pensions également qu'une analyse
historique-critique de la relation entre la science et le capital était
nécessaire. En 1972 (à l'époque de la guerre du Viêt Nam), j'ai assisté à
une conférence internationale sur l'histoire de la science dans
laquelle plusieurs physiciens, dont Paul Dirac, ont pris note d'une «
soumission massive de la science du capital », qui a commencé avec le
projet Manhattan pour la construction de la bombe nucléaire.
Dans
Agagar, vous avez exposé la critique du matérialisme dialectique de
Marx, qui ne considère pas le caractère génétique-structural des
processus psycholinguistiques et la synthèse sociale constituée par
l'évolution parallèle des structures économiques et des structures
linguistiques.
Oui, oui. Dans l'éducation en tant que processus productif
(Agaragar n.2, 1970), j'ai soulevé le problème de la genèse sociale.
Étant donné la forte dépendance à l'égard des soins parentaux et une
capacité remarquable à apprendre par l'expérience, l'évolution
biologique de l'espèce humaine s'étend à une évolution sociale médiatisée
par un processus éducatif. Un système de signes qui médiatise socialement la relation entre l'homme et la nature devient ainsi un «code
génétique» de sociétés humaines spécifiques comprises comme des «espèces
sémiotiques». Une hypothèse similaire, de la prolongation de
l'évolution biologique dans l'évolution sociale, a ensuite été formulée
par le biologiste évolutionniste Stephen Jay Gould dans l'essai Ontogeny et Phylogeny (Belknap Press of Harvard University Press, 1977). Dans l'économie commerciale et le langage rationnel: argent et logos
(Agaragar n.3, 1971), j'ai ensuite posé le problème de la synthèse
sociale compte tenu de l'évolution «isomorphe» parallèle des
déterminations formelles de la politique économique et du langage
rationnel dans la société grecque classique. Une corrélation similaire
entre la langue et l'économie dans la polis grecque a été mise en
évidence par le philosophe Sohn-Rethel In Intellectual Work and Manual Work: pour la théorie de la synthèse sociale (Feltrinelli, 1977), mais alors je ne connaissais pas ses recherches, elles n'avaient pas encore été traduites.
Après avoir collaboré avec Perniola, comment vos recherches ont-elles continué ?
De 1973 à 2005, j'ai enseigné les mathématiques et la physique au
Liceo scientifico Eugenio Curiel à Padoue, où j'ai été le promoteur de
l'introduction de l'histoire des sciences dans l'enseignement et parmi
les organisateurs et les orateurs du projet Ipazia pour la promotion de
la culture scientifique dans les lycées. À ce moment-là, j'ai écrit les révolutions isomorphes parallèles sages. Copernicus, Ariosto et Josquin de Prez (publié plus tard par Aracne en 2015), dans lequel je mets l'accent sur la synthèse sociale entre les sphères économique, cosmologique, littéraire et musicale à l'époque de la constitution de l'état politique moderne et des modèles dynamiques de l'évolution de la civilisation urbaine
(publié plus tard par Aracne en 2022), dans laquelle je considère la
genèse sociale du capitalisme. En 2018, j'ai écrit un dernier essai
intitulé Capital financier et populisme. La science dans l'évolution du capital
(Aracne, 2020), dans laquelle je considère l'évolution parallèle de
l'économie et de la science politiques dans les trois étapes
fondamentales de l'évolution du capital.
[COUPURE]
L'analyse
de ces formes de pouvoir l'a-t-elle également amenée à identifier et/ou
proposer de nouvelles possibilités d'affrontement, de conflit, de
changement?
Je pense que la conception d’une décroissance heureuse et l’opposition du souverainisme populiste au mondialisme néolibéral - comme l’opposition
politique des propriétaires terriens de la politique grecque au
capitalisme commercial - sont réactionnaires car ils limitent
le développement de la capacité humaine de production et de
communication. Dans la Renaissance de Mirandola, Pico della Mirandola a
déclaré que l'homme a la capacité extraordinaire de produire les plus
grandes innovations et les pires atrocités. Malheureusement, l'évolution
du capitalisme s'est détériorée. Il s'agit d'une évolution de la
direction et, d'une part, de réduire au minimum l'augmentation de l'incertitude en répartissant à l'ensemble de la communauté la richesse des informations
accumulées par un petit groupe dominant, d'autre part, pour réduire au
minimum l'augmentation de l'environnement. Les mouvements artistiques et
littéraires de gauche qui, comme le situationnisme, le «rando» des
mondes alternatifs possibles, ne considèrent pas le fait qu'une
réduction en esclavage de la science soit la base du pouvoir du capital.
L'"imagination au pouvoir" n'est possible qu'avec le détournement
de la production scientifique et technologique pour la mettre au
service de l'ensemble de la communauté et avec une nouvelle synthèse
sociale entre la narration et la production qui réalise d'éventuels mondes alternatifs à ceux proposés par le capital.