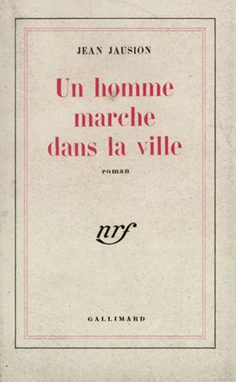C’est
un film assez particulier. Une sorte de produit hybride entre le film
noir et le drame social. Il a été réalisé par Marcello Pagliero qui
n’est pas très connu en tant que réalisateur, si ce n’est pour son
adaptation de la pièce de Jean-Paul Sartre, La p… respectueuse. Il a été aussi acteur et son nom se retrouve au générique d’un film malheureusement invisible aujourd’hui, de Jacques Deray, Symphonie pour un massacre. Franco-italien, il a fait carrière des deux côtés des Alpes.
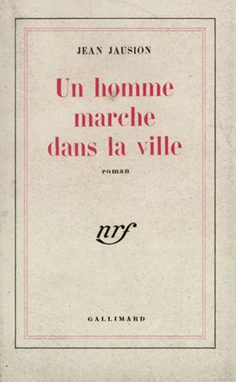
On ne connait pas grand-chose de Jean Jausion
qui est à l’origine du roman. On sait que ce fut un jeune homme de
bonne famille, plutôt porté vers la poésie et la littérature, il
participa à des groupes littéraires plutôt proche des tendances
surréalistes. Il était amoureux d’une jeune femme juive, Annette Zelman,
avec qui il devait se marier, mais ce mariage n’eut pas lieu car le
propre père de Jean Jausion la dénonça aux Allemands et elle fut
déportée et mourut en juin 1942 à Auschwitz. Jean Jausion s’engagea dans
la Résistance, participa à la Libération de Paris, puis fut tué en
Allemagne alors qu’il s’y trouvait comme reporter de guerre. Son livre,
son seul roman, sera publié de manière posthume en 1945 par Gallimard.

L’embauche sur les docks
Sur
les docks du Havre, la vie est dure, l’embauche irrégulière et la paye
maigre. Les dockers ont du mal à joindre les deux bouts et plus encore à
se loger dans une ville ravagée par la guerre. Laurent est un de
ceux-là, ouvrier mal embouché, il a un petit garçon avec Madeleine que
son patron drague ostensiblement. Jean qui est chef d’équipe est son
copain. Mais quand Laurent lui demande d’intercéder auprès du patron
pour avoir une meilleure place, Jean va se heurter à une fin de
non-recevoir, Ambilares « n’aime pas sa gueule ». Laurent lui en veut,
comme il en veut à sa propre femme. Un jour qu’il travaille avec un noir
un peu malade, ce dernier tombe de fatigue, le patron en profite pour
virer Laurent. Ce dernier est d’autant plus en colère que sa femme est
partie draguer Jean dans la ville. De fil en aiguille, et avec plusieurs
verres dans le nez, Laurent va chercher à frapper Jean dans une partie
déserte du port. Mais il s’est trompé de personne et a engagé une
bataille avec un autre docker ivre qui le rosse et le projette dans la
fosse où on répare les bateaux. Laurent meurt. Péniblement le lendemain
on remontera son corps. La police évidemment mène l’enquête. Madeleine
veut croire que c’est Jean qui, par amour, a tué Laurent. Celui-ci
essaie de lui dire qu’elle fait fausse route, mais elle ne veut rien
comprendre. La sœur de Madeleine est venue la soutenir dans l’épreuve,
et Jean revient le lendemain pour porter une collecte que les ouvriers
ont faite pour soutenir Madeleine et son gosse. Madeleine s’entête. Elle
n’ira même pas à l’enterrement. D’abord elle relance Jean jusqu’au
bistrot où il se noircit proprement, il l’envoie promener sans trop de
ménagement, ensuite elle va le dénoncer à la police comme le meurtrier
de son mari. Mais le commissaire qui a déjà enquêté sur Jean, ne semble
pas trop la croire. Bientôt Jean est innocenté. Il s’en va voir
Madeleine pour lui pardonner son attitude, mais c’est trop tard, elle
s’est suicidée de désespoir.

Entre Laurent et Madeleine rien ne va plus
Le
film comporte deux parties distinctes : il y a d’abord la misère
ouvrière et les dégâts qu’elle engendre dans les familles. C’est raconté
avec beaucoup de minutie, avec un sens du décor très réaliste. Les
conditions de travail sont dures, et les intérieurs des maisons,
misérables. Cela mène au drame, c’est-à-dire à la rupture de l’amitié
entre Jean et Laurent, et la mort de celui-ci puis l’enquête policière
qui forme la seconde partie. Ces deux parties sont très équilibrées,
mais elles sont filmées de manière assez différente. La première partie
met en scène le jour et le travail, la foule et les bateaux qu’on répare
où qu’on décharge. La seconde se passe plutôt la nuit, les individus
sont détachés de leurs fonctions, isolés par des ombres menaçantes. Si
la première partie ressort de la littérature prolétarienne ou du
néo-réalisme italien, la seconde se rapproche du film noir par
l’utilisation des codes visuels. Mais il y a en plus quelque chose de
poétique dans cette errance de Jean, ou même dans la manière des
ouvriers de lever le coude. On boit en effet beaucoup, tellement même
que le patron du bistrot cherche à freiner les consommations.

Dans une bagarre, Laurent fait une chute mortelle
L’atmosphère du film rappelle par moment L’Atalante, le chef d’œuvre de
Jean Vigo. La ville du Havre est un personnage à part entière. Mais à
l’époque c’est encore une ville en ruine, à l’image de ces vies
prolétaires qui n’ont pas d’avenir. Elle a été en effet douloureusement
touchée par les bombardements alliés, notamment britanniques, elle en a
subi 132, et sa plus grande partie est rasée ! C’est la ville de Raymond
Queneau qui disait ne plus la reconnaître, même si après la Libération
on a mis des moyens importants pour la reconstruire. Le film se passe
donc pendant cette reconstruction. La ville est marquée par son passé
ouvrier, mais aussi par l’attrait du grand large. C’est bien ces lieux
qui sont représentés dans le cinéma d’avant-guerre, Quai des brumes par
exemple. L’attrait du grand-large, c’est forcément une ouverture sur le
rêve. C’est à partir du Havre qu’on s’embarquait sur des grands
paquebots pour aller en Amérique. Frédéric Dard dans les années
cinquante célèbrera cette possibilité dans plusieurs San-Antonio, mais
aussi dans des films comme L’étrange Monsieur Steve ou Trois jours à vivre. Evidemment
la démocratisation de l’aviation a tué ce rêve de navigation au
grand-large. Dans quelques scènes, Pagliero filmera des bateaux qui s’en
vont au loin, comme s’ils avaient de la chance de pouvoir fuir cette
ville en ruine. Et de fait cette mer si vaste et si calme dans le film
s’oppose aussi bien à la fureur des hommes qu’au délabrement de la
ville. Mais il reste encore quelques rues sombres autour du port, des
rues où il peut se passer beaucoup de drames.
C’est
l’occasion aussi de célébrer des figures centrales de l’imagerie
populaire de ces temps-là. Le bistrotier, ancien boxeur, un peu
traficoteur, notamment avec un Allemand un peu simple qui lui procure de
l’alcool. La pute plutôt sympathique qui de temps à autre reçoit aussi
un peu des gnons, et le gosse mélancolique et solitaire de Laurent et
Madeleine qui ne dit jamais rien, subissant déjà les aléas de la vie et
les moqueries de ses camarades. Le commissaire n’est pas tout à fait
bon-enfant, mais enfin il fait son métier sans être trop pointilleux,
comme s’il comprenait la misère dans laquelle baigne cette population
qu’il est chargé de surveiller. Le patron, Ambilares, un rien
concupiscant, pas très loyal avec ses employés, a aussi des réflexes
humains, il aimerait bien que Madeleine le regarde un peu. Ça n’arrivera
pas, elle est bien trop accrochée à son idéal ouvrier. Question de
classe si on veut. Elle n’est pas très loyale pourtant avec son propre
mari, mais de là à trahir sa classe, il y a un pas qu’elle ne franchira
pas. Il y a aussi quelque chose de très juste dans les habits usés et
mal foutus que portent les différents protagonistes, ça ne fait pas
déguisement. Les prolos portent la casquette avec laquelle ils jouent
parfois.

La sœur de Madeleine est venue lui apporter son soutien
La
distribution est adéquate à son sujet. Comme le film se passe dans un
milieu pauvre et prolétarien, on ne pouvait pas prendre des acteurs trop
glamour. Le film est construit autour de Jean-Pierre Kervien qui était
né au Havre. C’est lui qui incarne le prolo Jean Sauviot à la morale
rectiligne qui ne veut même pas regarder la femme d’un copain, malgré
les relances incessantes de Madeleine. Il faut dire que Saviot est un
homme que les femmes regardent, sur lequel elles se retournent. Kervien
ne retrouvera plus jamais un tel rôle, il sera abonné aux seconds rôles
et aux séries télévisées. Ginette Leclerc est Madeleine. C’est une
garce, et Ginette Leclerc en a joué des tonnes. Dans l’imaginaire
populaire elle était d’ailleurs associée à la femme de mauvaise vie,
sans doute est-ce cela qui lui a procuré des ennuis sérieux à la
Libération. Après tout elle s’était moins compromise qu’Arletty. Ici
c’est bien une garce, mais elle a des excuses, elle est une victime de
la misère et de la fatalité. Robert Dalban incarne Laurent. Il est
vraiment excellent, sans doute un de ses meilleurs rôles à l’écran. Il
est encore jeune, et ses traits ne sont pas déformés encore par
l’alcool. C’est lui la véritable révélation du film. Il a l’air moins
figé que les autres acteurs, plus naturel. Il faudrait citer aussi André
Valmy dans le rôle du commissaire et Dora Doll dans celui de la pute au
grand cœur. Et puis bien sûr Yves Deniau qui joue Albert, le patron du
bistrot un peu neurasthénique. C’est un acteur assez fin, peu théâtral,
bien qu’il soit par ailleurs chansonniers, et qu’on a vu un peu partout
dans le cinéma français des années trente jusqu’à la fin des années
cinquante. En 1951, il retrouvera Marcello Pagliero pour La rose rouge, un
film à la gloire du célèbre cabaret de Saint-Germain des Prés. Il
n’avait cependant qu’un physique de bistrotier qui lui limitait l’accès à
des rôles importants. Grégoire Aslan est Ambilares, le patron des
dockers, cauteleux et méchant, il est aussi très bien. On verra
également Fréhel, la grande chanteuse réaliste, dans le rôle d’une sorte
de maman qui couve toute une tripotée de noirs qui se font exploiter
honteusement sans oser rien dire.

Madeleine a donné rendez-vous à Jean
Sur
le plan cinématographique, il y a dans ce film quelques scènes vraiment
magnifiques, la remontée du corps de Laurent depuis le fond de la fosse
de réparation des navires, l’attente de madeleine qui a donné un
rendez-vous aléatoire à Jean. Ou encore lorsque le commissaire
raccompagne Madeleine après le départ du train qui emporte son fils
qu’elle a confié à sa sœur. Il y a une composition des plans qui est
tout à fait étonnante. Les scènes de bistrot sont peut-être plus
banales, quoique très justes sur le plan poétique et réaliste. On peut
citer encore la scène finale qui voit Jean s’éloigner de la maison de
Madeleine parmi les décombres de la ville, tandis que celle-ci a mis fin
à sa vie misérable.
C’est
une très bonne surprise que de retrouver ce film un peu trop négligé
par la critique, sans doute à l’époque on devait trouver qu’il sentait
un peu trop la transpiration. En tous les cas il offre une sorte de
témoignage, non pas documentaire, mais sur les rêveries d’une époque
révolue, il cerne peut-être mieux que beaucoup de livres savants la
mentalité prolétaire et ses désenchantements.

Par dépit Madeleine dénonce Jean comme meurtrier

Jean repart après avoir laissé une lettre à Madeleine